|
Dans de nombreuses chroniques sur les
gravures représentant Blâmont, est cité le nom de Hoefnagel.
Il était temps de lui consacrer un article plus détaillé.
Voir
-
Texte de la Gravure de Hoefnagel
- Hoefnagel et les gravures en couleurs
Joris (Georges, Georgius) Hoefnagel, peintre, miniaturiste,
voyageur et poète anversois, est né à Anvers en 1542. Il
serait mort à Vienne le 9 septembre 1601 ( ?
cette date, très précise est cité par certaines biographies,
sans donner de sources. Mais alors, comme le fait remarquer
Edouard Fétis, pourquoi existe-t-il dans le Civitates orbis terrarum
des planches signées de Hoefnagel et datées de 1617 ?
).
Contraint par son père de travailler dans l'entreprise
familiale de diamantaire, il étudie néanmoins les arts à
Malines avec Hans Bol (1543-1593), et voyage en Angleterre,
France et Espagne. Il en rapporte des dessins qui seront
exploités ultérieurement, dans les six volumes du
Civitates orbis terrarum que Georg Braun éditera à
Cologne de 1572 à 1617.
| Il épouse à Anvers le 12 novembre
1571, Suzanne van Onsen. (Noces peintes par François
Pourbus l'ancien 1545-1581). Après l'invasion d'Anvers
par les troupes espagnoles en 1576, l'entreprise
familiale et ruinée. |
 |
En 1577, Hoefnagel reprend ses voyages, accompagné de son ami le
géographe Ortelius : il visite successivement Augbourg,
Munich, Venise, et Rome, où il refuse les offres du cardinal
Farnèse pour honorer l'engagement de devenir artiste de cour
auprès de l'électeur de Bavière Albert V. Il voyage ensuite
à Naples, Venise, Munich, puis Insbrück où il réalise de
1582 à 1590 un missel pour l'archiduc Ferdinand d'Autriche.
On le voit ensuite continuer ses voyages (en Angleterre, à
Francfort en 1594, à Prague... où il complète ses
illustrations pour le Civitates Orbis Terrarum)
Il se fixe enfin à Vienne, où il s'adonne à la miniature et
à la poésie latine.
La notice biographique la plus complète sur Georges
Hoefnagel a été écrite par Edouard Fetis (1812-1909)
reproduite ci-dessous.
Ajoutons que le fils de Joris, Jacob (1575 Anvers - 1630), a
été vraisemblablement formé par son père à la peinture. Ils
travaillent ensemble dans les années 1590-1600 : en 1592,
Jacob publie des séries d'estampes d'après les dessins de
son père, et dès 1595 réalise des dessins, sans doute aussi pour le Civitates Orbis Terrarum
de Braun et Hogenberg. Il accompagne
son père à Prague en 1599, où il demeurera et sera nommé Kammermaler.
Les artistes belges à l'étranger: études biographiques
Edouard Fetis
1857
GEORGES HOEFNAGEL.
Encore une vocation contrariée et qui
trouve en elle-même la force nécessaire pour triompher des
obstacles. C'est un thème qui se reproduit dans une foule de
biographies d'artistes, varié seulement par quelques détails
particuliers. Le héros de ce roman, dont le début offre une
parfaite analogie avec tant d'autres chapitres de l'histoire
des hommes poussés par l'impulsion propre de leur nature
dans la sphère des travaux intellectuels, s'appelait Georges
Hoefnagel. Il est né à Anvers en 1545. Son père était un
riche marchand de diamants. Le trafic des pierres précieuses
était un des éléments nombreux de la prospérité de notre
métropole commerciale. Elles y étaient apportées par les
Portugais, suivant Guichardin. Cet écrivain nous apprend
qu'il y avait à Anvers, en 1560, c'est-à-dire à l'époque de
la jeunesse d'Hoefnagel, « cent vingt orfèvres, sans un
grand nombre de lapidaires et autres tailleurs et graveurs
de pierreries, lesquels, ajoute l'auteur, font des oeuvres
admirables. » On sait que de tout temps les négociants ont
mis une sorte de point d'honneur à ce que leurs fils
continuent après eux les opérations commerciales dans
lesquelles ils se sont eux-mêmes enrichis. La gloire de
perpétuer la maison qu'ils ont fondée ou dont ils ont reçu
le dépôt héréditaire, est celle dont ils sont le plus
jaloux, pour eux aussi bien que pour leurs descendants.
Cette gloire est préférée par eux à la fortune. Le père de
Georges Hoefnagel, imbu de ces idées, voulait que son fils
fût marchand de diamants comme lui. Cependant Georges
n'avait aucun penchant pour les transactions du commerce.
Artiste d'instinct, il passait à dessiner tout le temps
qu'il pouvait dérober à la surveillance paternelle. Ses
cahiers d'écolier étaient couverts de croquis où se
manifestaient et la justesse de son coup d'oeil et la fermeté
de sa main. Decamps nous dit qu'à défaut de papier, il
traçait sur le sable; mais ce n'est là sans doute qu'une
nouvelle édition de l'épisode si connu de la vie de Giotto,
et qui cette fois n'avait pas le mérite de la vraisemblance,
car il n'est guère permis de supposer que le fils du riche
négociant ait été réduit, comme le pauvre berger, à
esquisser sur le sable des images fugitives. Ce qui paraît
certain, c'est que Georges Hoefnagel ne pouvait pas donner
un libre cours à ses fantaisies pittoresques. Une de ces
circonstances qui viennent toujours à point en aide aux
hommes doués d'une vocation sérieuse, seconda notre jeune
dessinateur dans ses tentatives jusqu'alors peu fructueuses
pour vaincre la résistance de son père à des projets
qualifiés de rêves chimériques. Un ambassadeur de Savoie
étant venu visiter Anvers, entra chez Hoefnagel, le marchand
de diamants, pour faire quelques acquisitions. Pendant qu'on
se mettait en devoir de satisfaire à sa demande, il aperçut
dans un coin de la boutique Georges qui dessinait, selon son
habitude. L'ambassadeur s'approcha de lui, fut frappé des
dispositions qui se révélaient dans le simple caprice d'un
crayon encore inexpérimenté et en fit tout haut
l'observation. Le négociant, peu touché des éloges donnés à
son fils, se plaignit amèrement de la désobéissance de
celui-ci, ajoutant qu'il saurait bien toutefois le
contraindre à laisser là ses dessins pour s'occuper des
choses du commerce. L'ambassadeur lui déclara qu'il aurait
tort et il le lui prouva par de si bonnes raisons, outre
qu'il fit des achats assez considérables, que le marchand
finit par promettre de ne plus contrarier les penchants de
son fils. La parole d'un ambassadeur avait alors du poids,
et le plus fier bourgeois ne pouvait se soustraire
entièrement à son ascendant, fût-il de nos provinces où
régnait un sentiment si général et si vif d'indépendance.
Georges Hoefnagel, libre désormais de toute entrave, n'ayant
plus rien à démêler avec les arides travaux du négoce, se
livra entièrement à ses études favorites. Semblable aux
artistes de son temps, qui avaient, on est bien forcé de le
reconnaître, cette supériorité sur la plupart de ceux de
notre époque, il visait à des connaissances variées, et,
sans négliger le dessin, apprenait à lire dans les textes
originaux les grands écrivains de l'antiquité. On n'avait
pas encore inventé les spécialités, vilain mot et vilaine
chose; on ne croyait pas qu'il suffît à un homme de se
distinguer dans la pratique d'un art, et que l'habileté
qu'il pouvait y acquérir pût le dispenser de se mettre, par
d'autres études, en communication avec le reste du monde
intellectuel. Les talents du peintre, du graveur et de
l'architecte; ceux du statuaire, du poète et du musicien se
trouvaient souvent réunis chez le même artiste. On ne dira
pas que cette variété de connaissances était un obstacle au
complet développement de l'une d'elles; les oeuvres des
maîtres dont nous parlons feraient aisément foi du
contraire. Mais revenons à Georges Hoefnagel que nous avons
laissé en pleine possession d'une liberté dont il profitera
si bien.
Lorsqu'il crut son talent de dessinateur suffisamment formé
pour pouvoir commencer avec fruit une étude sérieuse de la
nature, Hoefnagel sollicita de son père l'autorisation de
voyager. Avec cette autorisation, il obtint ce qui lui était
nécessaire pour en pouvoir user, c'est-à-dire une pension
dont le marchand de diamants, réconcilié avec la peinture
par les arguments persuasifs de l'ambassadeur de Savoie,
éleva généreusement le chiffre.
Chaque artiste, on le sait, a une vocation particulière.
Celle de Georges Hoefnagel était la reproduction des scènes
extérieures de la nature. L'Espagne lui parut devoir offrir
d'abondantes ressources à son crayon. C'est donc vers cette
contrée qu'il se dirigea, en explorant la partie de la
France qu'il devait traverser pour y arriver. On voyageait
alors moins rapidement et moins commodément qu'aujourd'hui;
mais on voyageait de manière à connaître le pays parcouru,
ce qui n'a plus lieu, il faut en convenir. L'artiste qui
cheminait à pied, le sac sur le dos et le bâton à la main,
prenant parfois le coche pour franchir une plaine aride et
le quittant dès que le terrain redevenait accidenté, allait
bien mieux à son but que celui qui a recours aux moyens de
transport inventés par la civilisation moderne. Il ne se
bornait pas à visiter les grandes villes et leurs environs;
il pénétrait dans l'intérieur des terres et saisissait le
côté le plus caractéristique de la physionomie de chaque
pays. C'est ainsi que Georges Hoefnagel accomplit son
pèlerinage d'Espagne. Chemin faisant il dessinait un site
pittoresque, une ville ouverte ou fortifiée, un château
féodal, une chaumière, les costumes différents pour chaque
province et souvent même pour des cantons de la même
province. Aussi ses compositions, dont il sera parlé plus
tard, intéressent-elles par une foule de détails précieux
pour l'étude des moeurs du temps.
Après une longue absence, Georges Hoelnagel revint en
Belgique, rapportant une riche moisson de croquis. Il
n'était encore que dessinateur. Voulant devenir peintre, il
prit, dit-on, des leçons de Jean Bol, qui résidait à
Malines, ville où régnait alors une grande activité
intellectuelle et où l'on ne comptait pas moins de cent
cinquante ateliers, s'il faut en croire les historiens.
Notre artiste ne se sentait pas attiré vers la peinture à
l'huile. La miniature sur parchemin et la gouache étaient
les genres qu'il affectionnait. C'est ce qui lui fit
rechercher les conseils de Jean Bol, peintre en détrempe
justement renommé. Il mania bientôt le pinceau aussi
habilement que le crayon, et n'eut plus d'avis à demander
qu'à sa propre expérience.
Hoefnagel s'était fixé à Anvers, dans la maison de son père,
pour mettre à profit les matériaux qu'il avait rapportés
d'Espagne. Il y trouvait une douce et paisible existence.
Libre, indépendant, riche dans l'avenir, il ne connaissait
aucun des soucis, aucune des nécessités de la vie matérielle
contre lesquelles se débattent, dans leur jeunesse, la
plupart des artistes dont cette lutte de tous les instants
contre de prosaïques exigences, use souvent les forces avant
l'âge. Il pratiquait en toute sérénité d'esprit le culte des
Muses, s'il nous est permis d'employer cette expression de
la littérature fleurie, passant de la peinture à la poésie,
et qui plus est à la poésie latine. Une nuit, nuit funeste
pour la Belgique, tout l'échafaudage de son bonheur présent
et de ses espérances fut renversé. C'était le 3 novembre
1576. Les Espagnols étaient sortis de la citadelle et
s'étaient précipités, comme un torrent furieux, sur la
malheureuse cité d'Anvers qu'ils mettaient à feu et à sang.
L'incendie dévorait l'hôtel de ville avec son trésor
d'objets d'art; il anéantissait le quartier habité par les
plus riches négociants; les soldats de Romero et de
Navaresse, avides de meurtre et de pillage, pénétraient chez
les habitants et enlevaient tout ce qu'ils trouvaient
d'objets précieux. Il était impossible que le père d'Hoefnagel
pût se soustraire à leurs exactions. En vain s'était-il
empressé de cacher ses diamants et ses pierreries; il lui
fallut tout livrer sous peine de la vie. Sa ruine fut
complète. Combien ne dut-il pas se féliciter d'avoir cédé
aux conseils de l'ambassadeur de Savoie, en permettant à son
fils d'acquérir un talent qui devenait désormais son unique
ressource !
Georges Hoefnagel ne songea plus qu'à s'éloigner d'Anvers,
où tout devait réveiller en lui des souvenirs pénibles. A
cette triste époque de noire histoire, quiconque avait des
sentiments d'indépendance et de fierté, préférait
l'expatriation à l'humiliation de subir l'odieux régime qui
pesait sur nos malheureuses provinces. Hoefnagel se
disposait donc à reprendre le cours de ses voyages; mais une
pensée amère se mêlait cette fois au désir de voir des
contrées nouvelles et d'y chercher des sujets d'études, car
il s'agissait non d'une exploration temporaire, mais d'un
exil. Heureusement il trouva un compagnon, le célèbre
géographe Ortelius qui, lui aussi, éprouvait le besoin
d'aller au dehors respirer un air plus libre et qui,
d'ailleurs, avait un but scientifique à remplir dans ses
voyages: l'achèvement du Thésaurus geographicus, pour lequel
il avait déjà parcouru une partie de l'Europe, afin de
relever, d'après les inscriptions, les anciens noms de
lieux.
Hoefnagel et Ortelius quittèrent Anvers et se dirigèrent
vers l'Italie par l'Allemagne. Les deux voyageurs
s'arrêtèrent à Augsbourg, où ils furent reçus par les Fugger
avec la généreuse hospitalité que ces princes du commerce
européen se taisaient honneur d'exercer à l'égard des
savants et des artistes. Les belles collections de tableaux
et d'antiques formées par Raimond Fugger retinrent quelque
temps nos Anversois. Ils virent avec curiosité la chambre où
logea Charles-Quint à son retour de l'expédition de Tunis et
où le chef de l'opulente famille des Fugger avait régalé son
hôte illustre du feu d'un fagot de cannelle, allumé avec la
reconnaissance d'une somme considérable souscrite par le
puissant Empereur.
D'Augsbourg, Hoefnagel et Ortelius allèrent à Munich. Les
Fugger, qui étaient en relation avec tous les souverains de
l'Europe, leur avaient donné une lettre de recommandation
pour l'électeur de Bavière. Ce prince fit droit à la traite
tirée sur sa bienveillance. Il voulut guider en personne les
deux voyageurs dans leur première visite aux monuments de la
capitale. Ami des arts, il exprima à Hoefnagel le désir de
voir de ses ouvrages. Celui-ci lui fit remettre quelques
feuilles de vélin sur lesquelles s'était exercé son pinceau
ingénieux et patient. Ces miniatures, que sa modestie était
loin d'estimer à leur juste valeur, furent vivement admirées
de l'électeur, qui envoya, dès le lendemain, demander à
l'artiste d'indiquer le prix auquel il consentirait à s'en
défaire. Hoefnagel n'avait pas encore tiré partie de la
vente de ses dessins. Son père lui avait remis, à son
départ, une somme provenant des débris de sa fortune
anéantie dans le sac d'Anvers, et comme il n'était pas
encore à bout de ressources, il était sur le point de
répondre à l'électeur qu'il lui faisait gratuitement hommage
de ses peintures. Ortelius l'empêcha de céder à ce mouvement
d'une générosité tout à fait inopportune. Oubliait-il qu'il
ne devait plus compter que sur ses pinceaux pour s'assurer à
l'avenir des moyens d'existence ? N'était-ce pas commencer
très-heureusement l'exploitation de son talent à laquelle le
contraignait le sort, que de vendre ses ouvrages à un prince
renommé par son goût pour les arts ? Il débutait ainsi sous
les plus heureux auspices dans une carrière où son
amour-propre pourrait bien n'être pas toujours aussi ménagé.
Hoefnagel céda aux bonnes raisons que lui donnait Ortelius
et lui promit de mettre un prix aux miniatures dont
l'électeur avait exprimé le désir de faire l'acquisition.
Toutefois, comme il semblait ne pas se soucier d'entamer
directement cette négociation, Ortelius lui dit de ne s'en
point mêler et qu'il se chargeait de tout.
Ortelius alla trouver l'électeur, lui apprit qu'elle était
la position d'Hoefnagel, comment la ruine de son père
l'avait obligé de prendre au sérieux une profession qu'il
était destiné à n'exercer que comme amateur, et termina en
demandant cent écus d'or pour les dessins soumis au prince.
La somme fut comptée à l'instant au négociateur officieux
qui la porta tout joyeux à son ami. L'électeur ne s'en tint
pas là. Il proposa à notre artiste de se fixer à sa cour,
moyennant une pension d'un chiffre élevé. Hoefnagel opposa à
cette offre des obstacles qui en empêchaient la réalisation,
immédiate du moins. Il voulait poursuivre le voyage qu'il
avait entrepris avec Ortelius; et puis, ne sachant où il
établirait sa résidence, il avait laissé sa femme à Anvers
et il devait prendre des mesures pour la rapprocher de lui.
N'était-ce que cela ? Le prince pourvut à tout. Il fit
envoyer à la femme d'Hoefnagel une somme de deux cents écus
d'or pour qu'elle pût venir attendre son mari à Munich.
Quant à celui-ci, toute latitude lui fut donnée pour
terminer avec Ortelius son excursion en Italie.
Les biographes d'Hoefnagel et ceux d'Ortelius ont laissé peu
de détails sur le séjour qu'ont fait les deux Anversois au
delà des Alpes. Les principaux épisodes de leur voyage sont
cependant consignés dans les inscriptions des dessins d'Hoefnagel,
gravés dans un recueil dont nous aurons à parler longuement.
Decamps, qui a copié et mal copié Van Mander, selon son
habitude, dit que Georges Hoefnagel étant arrivé à Venise et
ne croyant pas que ses talents pussent suffire à sa
subsistance, prit le parti de se faire courtier; mais qu'il
fut détourné de ce projet par les encouragements du cardinal
Farnèse. La bévue est d'autant plus étrange, que Decamps
vient d'entretenir ses lecteurs des propositions faites à
Hoefnagel par l'électeur de Bavière pour le fixer à sa cour.
Le biographe français n'a pas compris Van Mander, lequel
affirme, au contraire, qu'Hoefnagel avait songé à s'établir
à Venise comme courtier de commerce, mais que l'heureuse
issue de la négociation dont s'était chargé Ortelius lui
montra le parti qu'il pourrait tirer de son talent. Decamps
a tout confondu d'ailleurs en plaçant à Venise les rapports
qu'il y eut entre Hoefnagel et le cardinal Farnèse. C'est à
Rome qu'Ortelius présenta son ami à ce protecteur des
savants et des artistes. Le cardinal fut émerveillé des
travaux du peintre anversois. Il lui offrit un traitement
considérable pour le décider à entrer à son service; mais
esclave de la parole qu'il avait donnée à l'électeur de
Bavière, il déclara ne pouvoir accepter.
De Rome Hoefnagel ne revint pas à Venise et de là à Munich,
comme l'ont écrit Van Mander et Decamps. Il alla visiter
Naples avec Ortelius, et fit même un assez long séjour dans
cette belle contrée qui offrait à son compagnon, ainsi qu'à
lui, d'inépuisables sujets d'études. L'art et la la science
firent leur profit de ce pèlerinage dont nos deux Flamands
ne virent pas arriver le terme sans regret. Hoefnagel a
tracé, au bas des dessins pris aux environs de Naples, des
inscriptions qui témoignent qu'aucun autre lieu ne fit sur
son esprit autant d'impression.
Les deux voyageurs parcoururent encore l'Italie dans toute
son étendue, pour revenir de Naples à Venise, s'arrêtant
partout où ils trouvaient, celui-ci le motif d'un dessin
pittoresque, celui-là des inscriptions à recueillir, des
faits de la géographie ancienne à constater, des curiosités
archéologiques à observer; car Ortelius était antiquaire
autant que géographe, ainsi qu'on en a pu juger par les
collections de bronzes et de médailles dont il avait formé,
dans sa maison d'Anvers, un musée plein d'intérêt.
Arrivés à Munich, Ortelius et Hoefnagel se séparèrent, le
premier pour retourner à Anvers coordonner les matériaux
qu'il avait rassemblés, le second pour prendre possession de
l'emploi que lui réservait l'électeur de Bavière. On cite ce
trait caractéristique des usages du temps, qu'outre son
traitement, Hoefnagel recevait chaque année du prince des
étoffes de velours et de soie pour ses habits.
L'archiduc d'Autriche Ferdinand eut occasion de voir les
peintures d'Hoefnagel et conçut pour le talent de l'artiste
anversois une si haute estime, qu'il fit de vives instances
auprès de l'électeur pour qu'il consentît à le laisser
passer à son service. Une cession pleine et entière de son
miniaturiste favori n'entrait pas dans les vues de
l'électeur; mais il le céda pour un certain temps à
l'archiduc. Cet arrangement convenait assez à Hoefnagel, en
ce qu'il lui fournissait l'occasion d'aller voir de nouveaux
sites. Ferdinand l'emmena, en effet, à Inspruck où il avait
sa cour, et, pour suivre de plus près des travaux auxquels
il portait un vif intérêt, il l'installa dans le château
d'Ambras, sa résidence. Hoefnagel fut chargé, par son
nouveau patron, d'illustrer un missel sur vélin. Il
consacra, dit-on, huit années à l'accomplissement de cette
tâche. On ne s'étonnera pas de la longueur du temps qu'il y
consacra, lorsqu'on saura que les marges du livre étaient
entièrement couvertes non pas seulement d'ornements,
d'arabesques et de guirlandes, mais de compositions
allégoriques se rapportant au texte et faites avec une
merveilleuse délicatesse de pinceau. Pendant les huit années
qu'il employa à l'exécution de ce chef-d'oeuvre, Hoefnagel
reçut de l'archiduc Ferdinand une somme annuelle de huit
cents florins, plus une somme de deux mille couronnes d'or
après son entier achèvement, plus encore une chaîne
magnifique, comme témoignage particulier de satisfaction.
Ces chiffres et ces actes parlent éloquemment en faveur des
princes qui savaient donner aux artistes de tels
encouragements et de telles récompenses.
La renommée que valurent à Hoefnagel des travaux d'une
perfection incomparable parvint jusqu'à l'empereur Rodolphe
qui avait une prédilection marquée pour les oeuvres des
artistes flamands, ainsi que nous l'avons dit dans notre
notice sur les Sadeler, et qui fît engager le miniaturiste
anversois à lui consacrer un talent dont l'électeur de
Bavière et l'archiduc Ferdinand tenaient de lui de si
brillantes preuves. Hoefnagel se rendit à ce désir de
l'Empereur. Il vint à Prague et peignit pour Rodolphe quatre
livres offrant la représentation des principales espèces
d'animaux: quadrupèdes, oiseaux, reptiles et poissons des
différentes parties du monde. Homme de goût et d'invention,
Hoefnagel n'aurait pas choisi de lui-même, sans doute, ces
arides sujets. Il y a lieu de croire qu'ils lui furent
indiqués par l'empereur Rodolphe, dont on sait le goût pour
les sciences naturelles. L'ingénieux et habile pinceau d'Hoefnagel
parvint à donner un intérêt d'art à des motifs de dessins,
qui, traités par d'autres, n'auraient eu qu'un mérite
d'exactitude scientifique. l'Empereur le récompensa
magnifiquement et lui assura une pension qui le rendit
indépendant.
Quoiqu'il n'eût eu, certes, qu'à se louer de la manière dont
il avait été traité par ses hauts et puissants protecteurs,
Hoefnagel éprouva le besoin d'échapper aux obligations
qu'impose le séjour des cours. L'électeur de Bavière,
l'archiduc d'Autriche, l'empereur Rodolphe ne s'étaient pas
seulement montrés généreux à son égard, ils lui avaient
témoigné cette considération plus précieuse au véritable
artiste que l'argent dont on paye ses oeuvres; mais cela
n'empêchait pas Hoefnagel d'aspirer à une existence
complètement libre. Avec l'agrément de l'Empereur, il se
retira à Vienne où il vécut dans l'aisance que lui avait
procurée ses pinceaux, partageant ses loisirs, disent Van
Mander et Decamps, entre la peinture et la poésie latine.
Hoefnagel n'a été considéré que comme miniaturiste par les
biographes, qui, à quelques faits de l'histoire de sa vie,
se sont bornés à ajouter l'indication des manuscrits qu'il
décora de somptueuses illustrations pour Ferdinand
d'Autriche et pour l'empereur Rodolphe. Si l'on s'en tenait
aux renseignements qu'ils ont donnés, on en serait réduit à
n'accorder à l'artiste qu'une admiration de confiance. Il
existe heureusement un recueil plein de gravures, d'après
les dessins d'Hoefnagel, mais dont personne ne parle, et qui
semble avoir été ignoré de tous les iconographes, bien qu'il
se trouve dans la plupart des grandes bibliothèques. Ce
recueil nous montre le talent du peintre anversois sous les
aspects les plus divers; il le fait apprécier comme peintre
de genre, paysagiste, archéologue, observateur et fidèle
interprète des moeurs des contrées qu'il visite; il nous
permet de le suivre dans ses voyages et de rectifier
beaucoup d'erreurs de ses historiens. D'où vient que
l'ouvrage en question, dont l'impression a multiplié les
exemplaires, n'a pas été connu des écrivains qui se sont
occupés d'Hoefnagel? Ce n'est pas que l'auteur se soit caché
sous le voile de l'anonyme, car les planches dont il a
fourni les dessins sont signées en toutes lettres, et datées
qui plus est. La cause véritable, c'est que la publication
dont il s'agit et qui ne comprend pas moins de six volumes
in-folio, n'est pas artistique, pour nous servir d'un
adjectif consacré par l'usage, mais géographique. Les
géographes, n'étant pas artistes, n'ont pas prêté
vraisemblablement une grande attention à l'élément
pittoresque du recueil; les artistes, n'étant pas
géographes, n'ont pas été chercher dans un livre qui ne
paraissait pas être fait pour eux les dessins du
miniaturiste de Rodolphe II. Telle est l'explication
plausible de l'oubli profond où est resté le plus important,
le seul accessible des témoignages du talent d'Hoefnagel.
Van Mander a bien dit qu'il avait donné au public un livre
contenant les dessins recueillis dans ses voyages; mais
cette indication vague et inexacte prouve qu'il n'a pas
connu l'ouvrage dont il parlait.
Le recueil si digne de fixer l'attention des artistes est
intitulé: Civitates orbis terrarum in aes incisae et excusae
et description topographica et politica illustratae,
collaborantibus Francisco Hohenbergio chalcographico, et
Georgio Hoefnagel. Coloniae ab anno1572 ad 1618, 6 vol. in-fol. L'auteur du texte était Georges Bruin, chanoine de
Cologne. Aux descriptions des principales villes des
différentes parties du monde, et surtout de l'Europe bien
entendu, sont jointes des vues en perspective, des plans,
des cartes, etc. fl a été fait une traduction française des
quatre premiers volumes.
On lit peu les préfaces; c'est un tort. Les préfaces de
beaucoup de vieux livres, dédaigneusement appelés bouquins
par les gens qui ont la prétention d'être de leur temps,
contiennent parfois des choses fort intéressantes et qu'on
chercherait vainement ailleurs. C'est ainsi que, dans
l'avant-propos de son Théâtre des cités du monde, Georges
Bruin parle du concours que lui ont prêté Ortelius et
Hoefnagel pour l'exécution de ce vaste ouvrage, concours
dont les biographes du premier n'ont pas plus fait mention
que ceux du second. Le naïf exposé que fait le chanoine de
Cologne du plan et des détails d'exécution de son livre est
intéressant à plus d'un titre. Après avoir recherché comment
les hommes se sont réunis en société, et quelles furent les
premières constructions qu'ils élevèrent pour leur servir de
demeures, en indiquant sommairement les progrès de
l'architecture depuis les temps primitifs, l'auteur paye un
tribut d'éloge et de reconnaissance à ses collaborateurs,
lesquels sont tous Belges, il est bon de le remarquer. Ses
premières félicitations s'adressent aux graveurs Simon
Novellanus (Van den Neuvel) et François Hogenbergh, de
Malines, « dont les mains artificieuses ont mis tant d'art
et de fidélité dans la reproduction des villes et des
édifices, et qui ont donné tous les détails de
l'architecture avec tant d'exactitude, qu'il ne semble pas
que ce soit l'image des cités que l'on voit, mais les cités
elles-mêmes par l'effet d'un artifice admirable. » Il ajoute
que ces villes, il les ont en partie dessinées eux-mêmes
d'après nature, et en partie reçues toutes peintes de ceux
qui les avaient visitées : on verra plus loin que ceci
s'adresse principalement à Hoefnagel. Le bon chanoine
exprime des idées très-justes sur le secours que l'art de la
gravure est venu prêter aux historiens et aux géographes
pour compléter leurs descriptions. « Ceux qui étudient
l'histoire, dit-il, savent combien une pérégrination
lointaine sert à acquérir la connaissance des choses. Les
usages des nations, les lois, les moeurs, les coutumes, se
comprennent beaucoup mieux en voyageant que par de simples
lectures. Quel jugement peut avoir celui qui n'a jamais
perdu de vue le clocher de sa paroisse et ne connaît rien
que par ouï-dire? » Georges Bruin cite, comme l'ayant
grandement aidé dans l'accomplissement de son oeuvre, Abraham
Ortel, bourgeois d'Anvers, cosmographe éminent entre tous
ceux de son temps. « Et ne méritent pas moins de grâces,
dit-il plus loin, ces grands admirateurs des sciences
excellentes Georges Hofnaghel (Hoefnagel), marchand
d'Anvers, et Corneille Caymox, desquels le premier nous a
très-courtoisement communiqué les figures et pourtraits des
villes d'Espagne tirées très-exactement au vif, et l'autre
aucunes cartes des cités d'Allemaigne. »
Dans la préface de la partie de son ouvrage où sont décrites
les villes d'Italie, le chanoine de Cologne confirme ce qui
a été dit de la vocation toute spontanée de Georges
Hoefnagel pour la peinture: « Le tout, dit-il, est pourtrait
et remontré en peinctures particulières de ce nostre théâtre
naïfvement par l'industrie de Georges Hoefnagel, natif
d'Anvers, peintre très-excellent, non par institution de
maître, ains de don très-rare de nature. »
En parcourant la série des planches jointes à la description
des villes d'Espagne dans le Théâtre des cités du monde, on
accompagne Hoefnagel dans sa pittoresque exploration, on
partage en quelque sorte les impressions qu'il a éprouvées,
tant son crayon en a été le sincère interprète. Citer ici
toutes les vues qu'il a données serait trop long et
d'ailleurs inutile. Nous nous bornerons à indiquer celles
qui témoignent de son esprit d'observation, et qui font
connaître le parti que les paysagistes, et même les peintres
d'histoire de notre temps, peuvent encore tirer de ses
dessins.
A Barcelone Hoefnagel prend une vue du port d'après laquelle
les peintres de marines peuvent concevoir une idée exacte de
la forme des galères espagnoles au milieu du XVlme siècle.
Dans les planches où sont représentées Séville et Cadix, le
dessinateur a placé au premier plan des groupes de danseurs
curieux à étudier pour les costumes et pour la forme des
instruments de l'orchestre populaire. Près d'Ecija, la
Stigis des Romains, chemine un chariot couvert de nattes
tressées qui nous montre la construction des véhicules
primitifs de l'Andalousie, lesquels n'ont peut-être pas
beaucoup changé dans un pays dont les raffinements de la
civilisation n'ont pas encore heureusement altéré la
physionomie caractéristique. Aux environs de Burgos, voici
des pâtres pittoresquement ajustés. Dans la planche de
Grenade, Hoefnagel réunit les types des différentes classes
de la population pour en représenter les costumes variés. Un
cavalier traverse le paysage ayant une senora en croupe.
Plus loin passe un âne chargé de jarres. Ce n'est pas un
détail inutile : le peintre a voulu montrer comment se
transportent les liquides dans cette partie de l'Espagne. A
Saint-Sébastien, Hoefnagel place le martyr dont cette cité a
pris le nom, attaché à un arbre et percé de flèches. Cette
figure est hardiment dessinée.
Non-seulement l'artiste anversois fournissait à l'éditeur du
Théâtre des cités du monde, les dessins de ses plus belles
planches; mais il lui communiquait parfois les descriptions
des contrées que reproduisait son crayon. Dans la vue
d'Antequera, par exemple, on éprouve quelque surprise à
l'aspect d'une jarre immense sur laquelle sont accoudés deux
paysans armés de longues piques. Serait-ce un bizarre
caprice du peintre ? Le texte vient nous donner une
explication nécessaire : « Ils ont en ce lieu, y est-il dit,
des vaisseaux de terre d'une grandeur extraordinaire et
d'une capacité digne d'être admirée, lesquels sont ventrus
et propres à garder toutes sortes de fruits et liqueurs,
comme eau, vin, huile, câpres, olives, etc. Nous avons eu
toutes ces choses de très-excellent personnage, Hoefnagel,
qui en a faict la pourtraicture et nous les a communiquez en
langage thieoys. »
Pareil avertissement est donné par l'éditeur à l'occasion
d'une vue de Velis-Malaga, à deux lieues de Malaga. Voici
ses paroles : « Le seigneur Hoefnagel, bien expérimenté en
plusieurs choses par un long usage et qui a veu à l'oeil ce
que nous avons ici traité, nous a assisté de cette
description. » Aucun détail de moeurs n'a été négligé par
notre artiste. Dans la planche dont il est ici question, il
a mis des voyageurs montés sur des mules et escortés par un
guide armé, comme ils le sont eux-mêmes, pour résister, le
cas échéant, aux attaques des classiques bandits espagnols.
A Xérès se présentent d'autres épisodes caractéristiques.
Deux cavaliers armés de longues lances et de boucliers
singuliers semblent prendre part à une lutte animée. D'une
autre part, voici des mules chargées de blé. Ce ne sont pas
des accessoires de fantaisie introduits par le peintre dans
le paysage, à cette seule fin de l'animer. Le texte nous
apprend que les fameux genêts d'Espagne, excellents à la
course et recherchés pour les tournois, viennent de cette
province, qui fournit, ajoute l'auteur, du blé aux Pays-Bas,
dans les temps de disette.
Dans une gorge des âpres montagnes de la Sierra Alhama, au
milieu d'imposantes masses de rochers, se dessine un
établissement de bains d'eaux thermales. Les costumes des
figures qui garnissent ce paysage ont un reste des formes
mauresques. A côté des scènes de l'intérieur des terres, se
placent des épisodes de la vie maritime : on voit à Conil,
localité située à six lieues de Gibraltar, des pêcheurs
dépeçant du poisson, le salant et le mettant en barils.
Qui non ha visto Sevilla non ha visto maraviglia, telle est
l'inscription mise par Hoefnagel à la grande et belle vue de
Séville. Cette estampe est une des pièces capitales de son
oeuvre. Elle a toute l'importance d'un tableau de genre, et
l'esprit avec lequel l'artiste a représenté une scène
piquante des moeurs du pays lui donne un intérêt qu'égalerait
difficilement une composition de pure fantaisie. Le sujet
est une double exécution judiciaire sans analogie avec les
pénalités de notre Code. La première est intitulée :
Execution de justicia de los cornados patientes. Le patient
est monté sur un âne portant, ajusté sur son cou, un bois de
cerf auquel sont fixés des drapeaux et des sonnettes; une
vieille femme le suit et le frappe d'une houssine; l'alcade
à cheval vient ensuite accompagné de deux estafiers; un
héraut, la trompette à la main, marche en tête du bizarre
cortège. La seconde scène de ce drame, moitié sérieux moitié
burlesque, porte pour inscription : Execution d'alcaguettas
publicas. Une femme s'avance sur un âne; elle a le haut du
corps nu et couvert de grosses mouches, attirées sans doute
par quelque matière dont elle est enduite. Des hommes du
peuple lui jettent des pierres. Sur le devant sont deux
grandes figures de femmes dont les costumes sont
supérieurement dessinés. A un plan reculé, ou voit Séville,
et dans la campagne une route couverte de squelettes de
chevaux. Cette planche est aussi remarquable par la
franchise de l'exécution que par l'originalité du sujet.
Bien qu'elle offre, comme nous l'avons dit, un double
épisode, le dessinateur a su mettre de l'ensemble dans sa
composition : Hoefnagel s'est montré là observateur et
peintre.
Deux planches sont consacrées à la ville de Cadix. Sur le
devant de la première sont deux grandes figures, un moine
vendeur de chapelets et de reliques, et une femme
parfaitement ajustée. Au loin des scènes militaires:
l'attaque d'un fort et un engagement de matelots. La seconde
planche est une composition Tort bien ordonnée et qu'on
regrette de ne pas voir traitée en peinture. Le sujet est
une pêche, c'est-à-dire la suite d'une pêche qui a réuni sur
la plage une foule nombreuse : des femmes font cuire le
poisson qu'elles distribuent aux amateurs; des gentilshommes
boivent à une cantine le xérès dans de longs verres. Il
s'agit probablement d'une fête locale. Un jeune homme se
tient à l'écart et joue de la guitare au bord de la mer; ce
n'est pas un pêcheur sans doute, car les poissons ne se
prennent pas plus aux sons de la guitare qu'à ceux de la
flûte.
Auprès de Grenade, dont la vue perspective se déploie dans
une grande planche d'un effet pittoresque, Hoefnagel a placé
un groupe de femmes se livrant à la danse, plaisir de toutes
les classes et de tous les âges en Espagne. Il va sans dire
que le tambour de basque joue là son rôle obligé. Les
costumes sont pleins de caractère; ou remarque surtout des
chaussures très-originales. Notre artiste pouvait-il ne pas
dessiner l'Alhambra ? II en donne un aspect d'ensemble et
des détails d'architecture. L'exactitude consciencieuse de
son crayon ne se signale pas moins dans la représentation de
Tolède. Après en avoir tracé une vue générale, il dessine à
part la cathédrale et le palais des rois. Le tout est
entouré d'un cartouche terminé, dans le bas, par le blason
archiépiscopal.
L'une des planches, qu'on peut surtout recommander à
l'attention des artistes pour les costumes, est celle de la
Sierra de San Adriano en Biscaia. On y voit une série de
grandes figures dont les ajustements sont terminés avec un
soin extrême. Des inscriptions, placées sous chaque groupe,
font connaître à quelles localités et à quelles classes de
la population appartiennent les personnages représentés. Ce
sont : une femme et une jeune fille noble de Biscaye; des
paysans et des paysannes de la même province allant au
marché; des femmes de St-Jean de Luz; des femmes de Bayonne
allant à l'église.
Hoefnagel fait de l'archéologie en passant. Il consacre une
planche à la représentation des antiquités de Jerenna ou
Gerenna aux environs de Séville. Ces antiquités, qui
consistent en sarcophages, urnes cinéraires, etc., ont été
trouvées, à ce que nous apprend le texte descriptif, dans la
métairie d'un négociant flamand nommé Henri Van Belle. Aux
deux côtés de la même estampe se dresse l'élégante tour de
la cathédrale de Séville dont les détails sont rendus avec
une grande délicatesse. Elle est représentée extérieurement
et intérieurement. L'artiste a montré un cavalier gravissant
sur sa mule les degrés de l'escalier qui conduit au sommet
de la tour, et afin qu'on ne croie pas qu'il s'est livré à
un caprice d'imagination, il a mis au bas : Observavit ac
delineavit Georgius Hoefnaglius, 1565. Nous voyons, en
effet, dans les anciennes descriptions de Séville que cet
escalier a une montée si douce et si imperceptible, qu'on y
peut aller soit à cheval, soit en chaise roulante. Nous ne
garantissons pas cette dernière assertion ; quant à la
première, elle est confirmée par le témoignage d'Hoefnagel.
Fidèle au rôle d'observateur qu'il s'est imposé, l'artiste
anversois prend soin d'introduire dans tous ses paysages des
épisodes caractéristiques relatifs aux moeurs, aux usages ou
à l'industrie des localités représentées. Ainsi, dans la vue
de Marchena, il place des ouvriers travaillant à
l'extraction du mercure; dans celle d'Ossuna, il montre la
manière très-singulière de battre le blé en le faisant
piétiner par des chevaux. Parfois il prend note d'une
tradition singulière. Lorsqu'il dessine la vue de Cabeças,
petite ville située entre Séville et Cadix, il ne manque pas
d'inscrire sur sa planche cette phrase : Non se hase nada nel consejo del Rei senza Cabeças (il ne se fait rien dans
le conseil du roi sans Cabeças), laquelle phrase renferme
une énigme pour ceux qui ne savent pas qu'elle avait été
prise pour devise par les habitants du lieu, non par
forfanterie, mais dans une innocente intention de jeu de
mots. Cabeças veut dire tête ou caboche. Le sens de la
devise est donc qu'on ne fait rien dans le conseil du roi
sans caboche. Nous ne citons cette particularité que pour
faire voir quel homme ponctuel était Hoefnagel et avec
quelle exactitude il recueillait tout ce qui pouvait
compléter ses études pittoresques et les rendre d'une vérité
plus frappante. Ainsi que nous le disions plus haut,
parcourir son oeuvre, c'est voyager. C'est sans doute pour ne
pas introduire dans ses planches des éléments imaginaires,
qu'il s'y est souvent placé lui-même à défaut d'autres
personnages. Dans la vue de Cabeças dont il vient d'être
question, il est au premier plan, assis sur une pierre, et
dessinant; dans celle de Zahara, citadelle réputée
imprenable, faisant partie du domaine des ducs d'Arcos,
Hoefnagel s'est représenté prenant un croquis sans descendre
de sa monture, tandis que le muletier qui l'accompagne se
désaltère à une outre, Un peu plus loin, il traverse à
cheval, sous la protection d'un guide armé d'une hallebarde,
les montagnes abruptes qui entourent Loxa. Faute de
personnages appartenant à l'espèce humaine, et lorsqu'il ne
veut pas se mettre lui-même en scène, il se sert d'animaux
pour étoffer ses paysages. Il excellait à les peindre, ainsi
qu'on l'a vu par les manuscrits qu'il fit pour l'empereur
Rodolphe. Au premier plan de la vue d'Ardales, des perdrix
occupent le premier plan; dans celle de Cartama, ce sont des
lièvres. A Alcantarilla, nous voyons une chasse au canard
dans des marais qui entourent la ville; près de Bornes,
l'artiste nous fait assister à une chasse au chien courant.
Le voyage d'Hoefnagel en France présente moins d'intérêt que
celui d'Espagne, parce que le peintre a eu à retracer une
nature moins différente de celle de notre pays, ainsi que
des moeurs qui nous sont plus connues; mais parmi les dessins
qu'il y a recueillis, on en remarque cependant qui sont
dignes d'attention. Nous citerons la vue d'Orléans, où une
dame se promène une quenouille à la main et filant, suivant
l'usage de l'époque, tandis qu'un jeune seigneur semble lui
tenir de doux propos et lui offre une fleur. Les costumes de
ces deux personnages et ceux des blanchisseuses rangées sur
les bords de la Loire ont du caractère. Nous citerons encore
la vue de Bourges pour de singuliers ajustements de femme;
celle de Tours et d'Angers pour des motifs semblables;
celles de Lyon et de Vienne en Dauphiné pour la beauté des
paysages. La vue de Poitiers est surtout curieuse à cause
d'une particularité où se manifeste l'originalité du
caractère de notre artiste. En dessinant le monument
celtique connu sous le nom de la Pierre levée, Hoefnagel
représente plusieurs voyageurs occupés à inscrire leurs noms
sur le bloc principal; il vient lui-même d'y tracer ceux de
plusieurs de ses amis : Bruin, Ortelius, Mercator et
Mostaert.
C'est après avoir visité l'Espagne et la France qu'Hoefnagel
part pour l'Italie; nous avons dit dans quelles
circonstances. Les estampes où sont retracés les souvenirs
de ce voyage ont un double attrait. Elles montrent un
progrès dans le talent de l'artiste et nous initient plus
que les précédentes à ses impressions personnelles. En
passant à Pesaro, ce qui le frappe, ce sont de beaux
costumes de femme : il les dessine d'un crayon libre et
facile. A Terracine, il esquisse avec esprit et un grand
sentiment de la nature un joli groupe de paysans et de
femmes de la campagne occupés à cueillir des fruits. Sur la
route de Velletri à Rome, on voit deux voyageurs à cheval.
Ces deux voyageurs sont Hoefnagel et Ortelius. Une
inscription mise sous une vue essentiellement pittoresque de
Tivoli nous apprend que les deux amis y font halte le 1er
février 1578. Voilà des indications bien intimes, bien
précises et dont il est surprenant que les biographes
n'aient pas fait leur profit. Le peintre devient de plus en
plus prodigue de ces inscriptions, dans lesquelles se
reflète son esprit, qui font connaître l'homme en même temps
que l'artiste, et que, pour cette raison, nous enregistrons
avec soin. Voyez l'estampe où est représentée la route de
Mola à Gaete. Les deux Anversois s'y sont arrêtés pour
contempler les beaux vergers d'orangers et de citronniers
que baignent les rives d'une mer d'azur. Ce n'est pas notre
fantaisie qui se plaît à donner les noms du géographe et de
l'artiste flamands à des personnages imaginaires. Sous l'un
d'eux se lit l'inscription suivante : Georgius Hoefnagel
elegantissimi ad mare Tyrreneum Cajetae prospectus depictor.
Sous l'autre sont ces mots : Abrahamus Ortelius, studiosus
contemplator admiratorque itineris napolitanici cornes
jucundissimus. Ortelius étend la main dans la direction de
la mer et semble faire admirer les beautés du paysage à son
compagnon.
La planche double que nous allons décrire est aussi des plus
curieuses. Dans un des compartiments se trouve une vue du
lac Agnano dessinée avec une extrême délicatesse. Ortelius
et Hoefnagel sont encore au premier plan, celui-ci
dessinant, celui-là décrivant. Remarquez ces canards sur le
lac; ils ne sont pas un vain accessoire du paysage,
l'artiste les a placés là avec intention, comme étant en
contradiction manifeste avec le préjugé qui veut que cette
onde maudite soit mortelle aux oiseaux imprudents qui
s'aventureraient sur ses rives. Jugez-en par l'inscription :
A Ortelius G. Hoefnagel hunc locum hodie non esse Aopuov
animadvertentes. Les motifs du second compartiment est une
vue de la célèbre grotte du Chien. Au-dessus de l'entrée se
tient la figure allégorique de la Mort armée d'une flèche;
le mot Temerariis s'échappe de sa bouche osseuse. Plus loin,
un homme court baigner le chien, soumis à l'épreuve de
l'antre redoutable, dans les eaux du lac qui, si elles
donnent la mort aux êtres vivants, ont en revanche la
propriété de rendre à la vie ceux que des émanations
délétères ont menacés d'un prochain trépas. Le tout est
encadré de cartouches remplis par des inscriptions
explicatives, des citations de Virgile, etc.
La Solfatare, mine de soufre, près de Pouzzoles, fournit à
Hoefnagel le sujet d'une composition bizarre. L'eau thermale
dont il existe une source en ce lieu passe pour donner la
fécondité aux femmes. Le caustique artiste y fait arriver
deux dames, l'une à pied, l'autre en litière. Deux jeunes
gens paraissent les attendre. C'est évidemment une allusion
à la vertu de la source, sinon à celle des Napolitaines.
Deux figures allégoriques, celles de l'Envie et de
l'Ignorance, relient les deux extrémités d'un encadrement
compliqué. Armées chacune d'un marteau, elles forgent sur
une enclume un grand clou portant le nom de Georgius; plus
bas, on lit ces mots : Dum extendar. Le clou, c'est
l'instrument, c'est l'arme de l'artiste que lui préparent
l'Envie et la Jalousie; mais c'est aussi la représentation
figurée de l'artiste lui-même, car Hoefnagel veut dire en
allemand clou de maréchal. Ces subtilités paraîtraient
puériles à l'époque où nous sommes, mais elles étaient tout
à fait conformes à l'esprit du temps.
La planche qui représente la place Saint-Marc et le palais
des doges à Venise est d'un intérêt plus sérieux. C'est,
suivant nous, la plus remarquable de l'oeuvre d'Hoefnagel. La
célèbre basilique est dessinée à merveille; la place, animée
par des groupes de Vénitiens et de personnages du Levant,
est d'une grande vérité d'aspect. Le palais des doges est
représenté au moment d'un incendie. Il y a un grand
mouvement dans cette composition, où les figures sont
nombreuses et bien distribuées.
Comme souvenir de leur voyage d'Italie, Hoefnagel adresse à
Ortelius une vue du golfe de Baies, charmant paysage dans un
encadrement formé de deux grandes cornes d'abondance d'où
s'échappent des fruits de toute espèce. Il y joint non pas
une simple inscription, mais une sorte de lettre, en latin,
où il exprime à Ortelius le charme que lui a fait éprouver
la vue de ce beau pays chanté par les poètes, et le plaisir
qu'il eut surtout à le visiter avec un compagnon tel qu'Ortelius.
Il se rappelle le vers d'Horace:
Nullus in orbe sinus Baiis praelucet amoenis,
et il veut le donner pour titre à sa planche; mais ses
souvenirs le servent mal et il écrit : Nullus in orbe locus
praelucet amoenis Baiis. C'est de Munich qu'il adresse son
dessin à l'illustre géographe; il le date : Ex nostro museo
Bavarico Cal. Martii, anno 1580.
La collection publiée par Marco Pagliarini, sous le titre de
: Raccolta di lettere sulla pittura, scultura ed
architettura, renferme une lettre d'Hoefnagel, où l'on
trouve de curieux renseignements sur le prix des dessins au
XVIme siècle. Cette lettre est adressée au cavalier Gaddi,
possesseur d'une riche galerie de tableaux, statues, camées,
etc, qui avait chargé notre artiste, à. son passage à
Florence, de lui procurer des dessins des maîtres célèbres
de l'époque. Elle est en italien; en voici la traduction:
M. Giacomo, orfèvre, m'a écrit plusieurs fois, de la part
de Votre Seigneurie, que si je trouvais des dessins de bons
maîtres, je devais lui en procurer quelques-uns. Je lui ai
répondu que je pouvais en trouver, mais que les
propriétaires ne voulaient pas les envoyer en Italie, pour
en proposer la vente, et que je désirais connaître les
intentions de Votre Seigneurie. Le même Giacomo me dit alors
que les occupations de Votre Seigneurie ne lui permettaient
pas d'écrire; mais que si je trouvais quelques dessins
dignes du cabinet de Votre Seigneurie, à des prix honnêtes,
je devais les acheter. D'après cela, je n'ai pas voulu
manquer de donner à Votre Seigneurie une preuve de mon
dévouement et de mon désir d'augmenter et de conduire à la
perfection ce cabinet qui, certainement, en matière de
dessins, est le plus beau qu'on puisse voir et que tout
véritable amateur doit être porté d'inclination à augmenter
de plus en plus. Entre tous, Votre Seigneurie me trouvera un
des plus disposés à obéir à tous ses ordres. Vous recevrez
donc des mains de M. Giacomo. vingt neuf grands dessins et
six petits, qui coûtent, l'un dans l'autre, un écu d'or en
or (ici on n'en connaît pas d'autres) par dessin, pour
lesquels je me suis engagé, par une obligation de ma main, à
payer dans six semaines ou deux mois. Votre Seigneurie
voudra bien donner ordre pour que je sois pourvu à temps.
Comme le verra Votre Seigneurie, je n'ai pris ni esquisses,
ni dessins en mauvais état, ni de maîtres vulgaires, mais
tous de très-bonnes mains, lesquels les vendeurs ne m'ont
cédés à un prix si modéré que parce que nous sommes amis et
dans l'espoir de recevoir une plus grande commande. Ces
dessins sont tous de la sorte moyenne, car il y en a encore
de plus simples et de moindre prix, comme aussi de plus
grand prix et d'une plus grande valeur. Ils sont beaux et
finis; ce sont, sous tous les rapports, des dessins parfaits
et des plus vaillants et anciens maîtres allemands et
flamands, comme : Albert (Durer); Luca (Lucas de Leyde); Olbein (Holbein); Patenier; Emskerken (Heemskerck); Jean et
son frère Hubert Van Eyck, très-anciens; Quentin (Metsys) ;
Mabuse et beaucoup d'autres, et aussi des modernes, de
Raphaël, etc., tous dessins finis et d'importance, et pour
cela dignes d'être estimés comme ils le sont en effet. Je
n'ai pas voulu m'en occuper sans connaître l'intention de
Votre Seigneurie. J'aurais voulu persuader aux propriétaires
de ces dessins de m'en confier cinquante ou soixante pour
vous les envoyer; mais ils ne le veulent pas. Si Votre
Seigneurie le désire et me le commande, je pourrai prendre
la note des principaux et du prix qu'on en demande, et la
lui envoyer. Ce serait une chose bonne et profitable
d'employer cent ou cent cinquante écus à en acquérir une
partie. Je suis persuadé qu'on me laisserait, en ce cas,
choisir les meilleurs et les plus finis. Celui d'Albert
Durer ne me serait pas laissé à moins de quatre écus, celui
de Lucas trois, le grand de Patenier trois, et ainsi des
autres. Je n'ajouterai plus rien maintenant, et j'attends
les ordres de Votre Seigneurie. Ce 12 février 1577.
GEORGIO HOEFNAGEL.
Hoefnagel a aussi exécuté, pour le Théâtre des cités du
monde, plusieurs vues de villes d'Allemagne. Celle de Munich
est dédiée au duc Guillaume. Il continue à fournir au
chanoine de Cologne des indications pour le texte, en même
temps que des dessins. Nous en trouvons la preuve dans la
description du château situé près de Landshut, dans la basse
Bavière, et appartenant au prince-électeur. Après avoir
transcrit les lignes suivantes: « Ce château est embelli par
l'art et l'industrie de Frédéric Sustris, Hollandais
d'origine, mais Italien de nation, homme très ingénieux en
toutes sortes d'artifices, qui l'a orné de fontaines,
statues, peintures, chants et volements d'oiseaux, etc.,
l'éditeur ajoute : « La description de cette ville
(Landshut) nous a été communiquée par Georges Hoefnagel,
marchand d'Anvers, lequel, né aux études de la paix et non
de guerre, fuyant les troubles de la Belgique, ayant
perlustré l'Italie, s'est rendu au service du pacifique
prince Albert, duc de Bavière, s'employant pacifiquement en
l'art miniatoire, lequel la nature seule lui a enseigné. »
Ce passage n'est pas sans importance en ce qu'il confirme ce
qui a été dit du développement spontané du talent d'Hoefnagel
et de la cause de son départ d'Anvers.
Parmi les vues d'Allemagne dessinées par Hoefnagel, on
remarque encore celle où l'artiste a réuni sur une même
planche, une perspective étendue des Alpes tyroliennes et le
site où se trouve le monument élevé en souvenir de la
rencontre de Charles-Quint et de Ferdinand, au retour de
l'expédition contre les États barbaresques.
Il n'a été fait aucune mention du voyage d'Hoefnagel en
Angleterre. Il est cependant positif qu'il visita cette
contrée; des planches signées et datées en font foi. C'est
en 1582, entre son voyage en Italie avec Ortelius et le
moment où il se fixa à la cour de l'archiduc d'Autriche,
qu'il alla au pays d'outre-Manche. Il ne paraît pas qu'il y
ait fait un long séjour, car les vues qu'il y a prises pour
le Théâtre des cités du monde sont en petit nombre; mais le
peu qu'il en a donné est fort intéressant pour les costumes,
et peut être utilement consulté par les artistes qui
traiteraient des sujets de l'histoire d'Angleterre à la fin
du XVIme siècle. La planche où il a représenté le palais des
souverains de la Grande-Bretagne, édifice dont
l'architecture diffère essentiellement de celle de nos
monuments, est animée par un épisode bien caractéristique
des moeurs anglaises : un retour de la chasse. On y voit des
seigneurs à cheval, des voitures d'une forme singulière, des
piqueurs conduisant une meute, etc. A cette scène bien
composée, l'artiste a joint une série de grandes figures
très-curieuses pour les ajustements. Ce sont des femmes de
la cour, des femmes nobles, des bourgeoises, des marchandes,
des paysannes, etc. Dans une vue d'Oxford, notre artiste
nous montre deux docteurs devisant à l'ombre d'un chêne, ou
plutôt disputant, car les docteurs sont, on le sait, de
grands disputeurs. Une seconde planche non moins
intéressante nous offre une perspective de la ville et de
ses monuments, avec des personnages diversement costumés au
premier plan.
Indépendamment du concours direct qu'il prêtait à l'éditeur
du Théâtre des cités du monde, Hoefnagel s'était chargé de
lui fournir pour cet important ouvrage des matériaux
provenant de sources différentes. Il chargea son fils
Jacques, dessinateur et graveur, de parcourir la Bohême, la
Hongrie, la Croatie, la Transylvanie, et d'y recueillir des
vues qu'il envoie au chanoine de Cologne telles qu'il les a
reçues, ou dont il fait lui-même des dessins terminés
d'après de simples croquis. Toujours l'inscription mise au
bas des planches fait mention de la part qu'a prise
Hoefnagel à leur exécution. Sur les unes nous voyons :
Communicavit Georgius Houfnaglius, delineatum a filio; sur
d'autres : Depinxit et communicavit G. Houfnaglius delineatum
a filio. Ces planches sont généralement dessinées avec moins
de finesse que celles des vues d'Espagne, d'Italie et de
France, qui sont de la main de Georges Hoefnagel, mais elles
ne sont pas moins curieuses. Les figures y ont plus de
caractère; elles offrent, pour les costumes, des indications
d'une grande fidélité. A ce titre il est bon de les faire
connaître aux peintres.
Georges Hoefnagel mettait à contribution d'autres artistes
que son fils, pour enrichir l'ouvrage de Bruin des vues
qu'il n'avait pas prises lui-même dans ses voyages; mais
avec une conscience bien rare et qui ne se dément pas, il
indique dans les inscriptions les noms de ses
collaborateurs. C'est presque toujours à des compatriotes
fixés comme lui à l'étranger qu'il fait des emprunts. Au bas
de l'estampe représentant le Phare de Messine, nous trouvons
cette note intéressante : Repertum inter studia autographica
Pétri Breuggelii. pictoris nostri saeculi eximii,ab ipsomet
delineatum, communicavit G. Houfnaglius 1617. Breughel mort, Hoefnagel pouvait sans danger s'emparer de son oeuvre; mais
sa probité le lui défend.
Au bas de la vue de Linz, fort belle planche d'ailleurs, on
lit : « Effigiavit Lucas a Walckenburg; communicavit
Georgius Houfnaglius. La vue de Gmunden porte cette
inscription : Ex archetypo Lucoe Van Walckenborch, effigiavit
Georgius Houfnaglius anno 1594. Le peintre Lucas de Walckenbourg, dont il est ici question, est né à Malines, et
s'était fixé à Anvers quand les événements qui décidèrent
Hoefnagel à un exil volontaire, lui firent prendre aussi la
résolution de s'expatrier. Il se dirigea vers l'Allemagne et
trouva un protecteur dans l'archiduc Mathias, qui le prit à
son service. Il passa plusieurs années à Linz, près de ce
prince. Les noms de Lucas de Walckenbourg et d'Hoefnagel
sont réunis dans un compte des dépenses de l'archiduc
Ernest, pendant son voyage de Vienne à Prague et de Prague à
Bruxelles, d'octobre 1593 à juin 1594. On y trouve, sous la
rubrique de Francfort : « A maître Lucas, pour une vue de la
ville de Linz, 50 thalers. » Puis : « Pour les estampes d'Hoefnagel,
1 florin 40 sols. Pour relier les estampes d'Hoefnagel, 50
sols. » Sous la date de Bruxelles enfin : « Envoyé à maître
Lucas de Walckenbourg, peintre, 240 florins. » La vue de
Linz, achetée par l'archiduc Ernest, était vraisemblablement
l'original dont Hoefnagel a fait une copie. Cette
acquisition a eu lieu en 1594 et c'est précisément la date
que porte l'estampe du Théâtre des cités du monde. L'extrait
de compte que nous venons de citer prouve qu'Hoefnagel a
résidé à Francfort. C'est dans cette ville qu'il a eu
communication de Lucas de Walckenbourg, et qu'il a vendu à
l'archiduc, les estampes mentionnées dans le registre des
dépenses de celui-ci.
Une vue de Cassovia (Hongrie) porte cette inscription:
Depict. ab Egidio Van der Rye Belga; communicavit G.
Houfnaglius, 1617. Égide ou Gilles Van der Rey était un des
nombreux peintres flamands qui allaient, à cette époque,
chercher fortune à l'étranger. M. Nagler dit qu'il habita
Gratz, en Styrie, et qu'il y fut au service du duc Charles
Ier, dont il décora le palais de peintures à fresque. Le
musée de Vienne possède, de cet artiste, un tableau sur
cuivre représentant l'inhumation de sainte Catherine.
Nous avons dit qu'Hoefnagel indiquait, avec une conscience
scrupuleuse, la source d'où il avait tiré les dessins de
celles des vues qu'il n'avait pas prises lui-même d'après
nature. Quand il reproduisait l'oeuvre d'un confrère, il le
citait, fût-il mort comme Pierre Breughel. Lorsqu'il n'avait
eu pour éléments de son travail que des croquis anonymes, il
en faisait mention dans des inscriptions ainsi conçues :
Acceptum aliunde, ou : Communicavit G. Hoefnaglius, acceptum
ab alio, ou : Acceptum ab amico; communicavit, etc., ou
bien encore : Ex depicto aliorum;communicavit.
Tous les biographes d'Hoefnagel s'accordent à dire qu'il
mourut en 1600. S'ils avaient ouvert le Théâtre des cités du
monde, ils y auraient vu plusieurs planches signées de notre
artiste et portant la date de 1617. Le dernier volume de
l'ouvrage à la publication duquel il eut une si grande part,
ayant été imprimé en 1618 et ne contenant pas de dessins
postérieurs aux siens, on ignore jusqu'à quelle époque il
prolongea sa carrière.
Jacob Hoefnagel, ce fils de notre artiste dont nous avons
dit que de nombreux dessins, retouchés par son père, furent
donnés dans le grand ouvrage du chanoine de Cologne, était
graveur en même temps que peintre. Il publia en 1592, à
Francfort, un recueil de 52 planches en quatre parties,
intitulé : Archetypa studiaque patris Georgii Houfnaglii
Jacobus fil. genio duce ab ipso sculpta omnibus philomusis
amice dicat ac communicat. M. Brunet, dont l'exactitude
bibliographique est rarement en défaut, prend l'indication
de la parenté pour un nom patronymique, appelle l'artiste
Pat. Georg. Hoefnagel, et dit que le recueil se compose de
fleurs, de fruits et d'insectes.
Georges Hoefnagel a laissé un second fils, appelé Jean,
peintre qui paraît s'être appliqué particulièrement à
l'exécution de planches d'histoire naturelle, et s'être fait
une certaine renommée par des travaux de cette nature. On a
publié d'après lui, en 1650, un recueil ayant pour titre :Diversae
insectarum volatilium icones ad vivum accuratissime depictae
per celeberrimum pictorem D. J. Hoefnagel.
La Belgique ne possédait aucune production originale de
Georges Hoefnagel, lorsqu'une circonstance toute
providentielle vint permettre de combler cette lacune de nos
collections. En 1852, un Anglais qui avait résidé quelque
temps dans un des hôtels de Bruxelles, y laissa, ce qui se
voit quelquefois, un compte arriéré, en nantissement duquel
il remit une miniature enfumée. L'hôte n'estimait guère ce
gage; mais faute de mieux il l'accepta. L'Anglais ne s'étant
pas présenté pour acquitter sa dette à l'époque fixée, le
maître d'hôtel vint offrir au conservateur des manuscrits de
la bibliothèque de Bourgogne de lui céder la miniature en
question, contre le remboursement de la somme pour laquelle
elle était engagée. Le marché fut conclu, marché
très-heureux, car il mettait notre dépôt public en
possession d'une admirable peinture de Georges Hoefnagel,
signée de l'artiste et offrant le spécimen le plus complet
de son merveilleux talent. Le sujet est une vue de Séville
prise de la rive opposée du Guadalquivir, avec des groupes
de figures au premier plan, des barques de pêcheurs sur le
fleuve et une longue perspective de la ville au fond.
L'encadrement, d'une richesse inouïe, est formé des emblèmes
de la paix et de la guerre, des attributs des différents
règnes de la nature, avec une représentation allégorique de
la conquête de l'Amérique par l'Espagne, le tout couronné
par un portrait de Philippe II, assis sur un trône d'or
entre deux évêques. Cet encadrement échappe à l'analyse par
l'innombrable quantité d'objets qui s'y trouvent
représentés. L'exécution en est d'une délicatesse qui
dépasse tout ce qu'on connaît en ce genre, et cependant elle
est exempte de sécheresse. L'artiste a su allier le moelleux
de la touche avec le dernier degré du fini. Il a signé son
oeuvre en toutes lettres: Georgius Houfnagle antverpianus
faciebat anno 1573; et il ajoute natura sola magistra, car
c'était, on l'a déjà vu, sa grande prétention, de s'être
formé sans maître, et d'avoir un talent en quelque sorte de
révélation; outre la date de 1573, inscrite au bas de
l'encadrement, à la suite du nom d'Hoefnagel, on lit celle
de 1570, sous la vue de Séville. On n'en peut pas conclure
que le peintre ait employé trois années à l'exécution de
cette miniature; il s'y est sans doute repris à deux fois,
et l'idée d'entourer d'un somptueux encadrement sa vue de
Séville ne lui sera venue qu'après coup. Dans quelle
circonstance et pour quel grand personnage Hoefnagel a-l-il
fait ce chef-d'oeuvre de talent et de patience ? C'est ce
qu'on ignore. On peut affirmer seulement que sa peinture n'a
pas été faite dans le pays dont elle reproduit un site, car
il avait visité l'Espagne de 1563 à 1565, et à la date que
porte son dessin il était en Allemagne, de retour de sa
pérégrination à travers l'Italie.
Note
sur le clou : on notera sur la gravure
représentant Hoefnagel ci-dessus, la
présence du clou de maréchal ferrant, sens allemand de
Hoefnagel, dont Fétis rappelle qu'il a servi de signature à
l'artiste.
Cette signification n'a pas échappé à certains chercheurs :
on trouve ainsi dans le Bulletin historique et monumental
de l'Anjou de 1867-1868, une interrogation sur la vue
d'Angers en 1561 :
« Nous devons à l'obligeance d'un honorable négociant
d'Angers, M. Lucien Lévesque, très-versé dans l'étude des
antiquités de notre ville. la communication du curieux
dessin qui accompagne cette livraison. C'est une vue
générale de la ville d'Angers au seizième siècle.
L'observateur étant placé en reculée, a devant lui la Maine
et. la ville étagée sur la rive droite.
La gravure est signée G. Houfnaglius, ann. Dni. 1561.
Qui était-ce que G. Houfnaglius, dont le nom latinisé semble
indiquer une origine allemande ou hollandaise (1)? Toutes
les recherches que nous avons faites à ce sujet ne nous ont
rien fait découvrir. Nous ne savons pas non plus ce qui a pu
déterminer cet Houfnaglius à publier une vue d'Angers. Il
est certain toutefois que notre gravure a été détachée d'un
ouvrage in-folio, qui devait être une sorte de voyage à
travers la France, ou peut-être seulement une suite de
notices sur nos principales villes accompagnées de gravures.
En effet, un autre exemplaire, que possède M. L. Lévesque,
réunit à la fois cette même vue d'Angers et une vue de
Tours, Au verso de ce dernier exemplaire est une notice en
allemand; au verso du nôtre, la notice est en français. D'où
nous devons conclure très-facilement, que l'ouvrage enrichi
des dessins d'Houfnaglius a eu, au moins, deux éditions.
[...]
(1) Houfnaglius veut dire en Allemand « clou de fer à
cheval. » »
Et on retrouve effectivement le clou au centre de la
représentation de Solfatara du Civitates orbis terrarum,
forgé sur une enclume par les allégories de l'Envie et de
l'Ignorance, et portant le prénom du graveur :
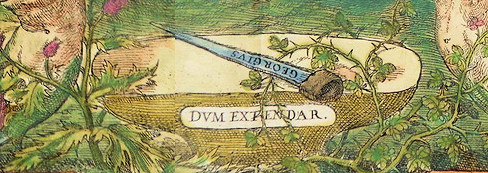
|
Rédaction :
Thierry Meurant |
|













