|
|
|
|
|
|
|
Nicolas de Mirbeck - Portrait de la famille de
Ligniville - 1791
|
|
Dans l'article
Nicolas de Mirbeck (1738-1795),
peintre, nous évoquions le peu d'oeuvres connues. Voici
ci-dessous une peinture inédite : le portrait de la famille de
Mathieu-Joseph de Ligniville, conservé aujourd'hui par les
descendants de la famille, et que nous remercions grandement
pour leur communication.

Nicolas de Mirbeck - 1791 -
Mathieu-Joseph de Ligniville et sa famille
Son attribution ne fait aucun doute : car le tableau porte une
étiquette indiquant « M. de Mirbeck », et la composition et le
style sont indéniablement du dernier seigneur de Barbas.
On sait que le fils, Michel-Nicolas de Mirbeck qui habitait aussi
Barbas, est effectivement parti en 1791 pour l'Allemagne ; mais
malgré la confusion sur la liste des émigrés, nous avions émis
de forts doutes concernant un départ similaire cette année là de
Nicolas Mirbeck. Notre précédent article confirme son
décès à Rouen en 1795 (lieu de résidence autorisé par le comité
de salut public en 1793 alors qu'il résidait à Paris chez son
frère Ignace-Frédéric). |
Le tableau peut-il nous en dire
davantage ?
La toile datée de 1791, de grande taille (71 x 59 cm) représente Mathieu-Joseph de Ligniville
(1734-1804), son épouse Madeleine Comte, et six enfants du couple
qui résidait à Deuxville (propriété Saint-Evre - Voir
Note en
bas de page).
Portait de
Mathieu-Joseph de Ligniville |
 |
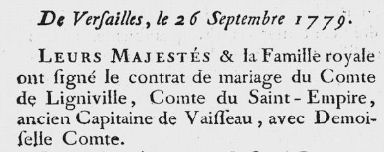 |
Gazette de France du 28 septembre 1779. L'autorisation royale
est nécessaire vue la minorité de l'épouse. |
Combien Mathieu-Joseph de Ligniville eut-il d'enfants ?
Le
nombre diffère selon les source : « Sept » selon l'Annuaire de
la noblesse de France de 1905, « huit » selon l'Annuaire de la
noblesse de France de 1853, ou « neuf » selon l'appendice C dans
Notice sur quelques anciens titres (de Delley De Blancmesnil,
1866) avec cette indication ; « - trois filles mortes sans
postérité - un fils mort en bas âge - et les 5 enfants
ci-dessus » (sont cités les cinq fils reportés dans le tableau
en bas de cette page).
Or le portrait ne présente que les six enfants, qu'ont trouve
d'ailleurs nés avant 1791 dans le tableau récapitulatif
ci-dessous.
Il est donc fort probable que le couple n'ait eu réellement que
huit enfants :
deux filles, et six garçons, dont un mort en bas âge, de sorte que sur
le portrait, on aurait de gauche à droite : Louis (4 ans),
Anne-Victoire (1 an), Pierre Joseph (9 ans),
Mathieu-Charles (6 ans), Rose-Madeleine (3 ans) et Anne (8 ans).
Par ailleurs, le tableau récapitulatif
de la famille
indique aussi des naissances ultérieures à Nancy et
Lunéville ; la famille de Ligniville n'a donc pas émigré, et
Nicolas de Mirbeck était alors encore en Lorraine en 1791, du
moins à l'époque du portrait où Anne-Victoire (née le 17 avril
1790) est encore au berceau.
Il restait aussi en contact avec le seigneur d'Herbéviller,
René-Charles-Élisabeth de Ligniville
(1760-1813), neveu de Mathieu Joseph, et
Anne-Marguerite-Charlotte, soeur de Mathieu Joseph (1740-?,
mariée le 2 juillet 1759 avec François Baudon ) : c'est cette «
veuve Baudon » qui, à Rouen en 1795, recommande Nicolas Mirbeck
comme peintre à « la citoyenne Choiseul » (Marie-Eugénie de
Rouillé du Coudray, 1759-1815, épouse de Michel-Félix de
Choiseul d'Aillecourt, qui a divorcé en mai 1792, Michel-Félix
ayant émigré) pour le portrait de sa fille Ambroisine Honorine
Zoé (1787-1846). Nous ignorons d'ailleurs si ce portrait a été
réalisé...
Quand Nicolas de Mirbeck a-t-il quitté Barbas pour se rendre à Paris ? A ce jour, rien ne permet de le déterminer, et le secret dont
s'entourait utilement les ex-nobles durant ces années troubles
ne nous laisse guère espérer une réponse à cette question.
|
|
|
|
|
|
|
Naissance |
Décès |
Mariage |
|
|
Mathieu Joseph de LIGNIVILLE |
|
3 décembre 1734, Nancy (54, paroisse
Saint-Nicolas) |
24 septembre 1804 (2
vendémiaire an XIII), Saint-Dié (88) |
13 septembre 1779, Ile de Grenade
(Paroisse Notre Dame de l'Assomption, Petites-Antilles britanniques), avec Madeleine COMTE |
Page du Roi Stanislas, puis enseigne
de vaisseau et capitaine de bombardiers à Brest (1770),
capitaine de vaisseau (1774), chevalier de Saint-Louis |
|
|
Pierre Joseph de LIGNIVILLE |
19 février 1782, Boulay (57) |
19 décembre 1840, Nantes (44, 2e
canton) |
1815, avec Clémentine
Maximilienne
BÉRAUD de COURVILLE |
Engagé volontaire en 1798,
lieutenant-colonel de dragons et aide de camp du prince
d'Essling (1809), colonel du 16ème dragons (6 février
1814), maréchal de camp (21 mai 1825, inspecteur général
des colonies (1837) Chevalier de la Légion d'honneur (14
mai 1807), officier (21 août 1823), commandeur (15
octobre 1837) Chevalier de Saint-Louis |
|
|
Anne de LIGNIVILLE |
28 décembre 1783 (à minuit),
Deuxville, Saint-Evre (54) * |
14 août 1874, Paris (75) |
| |
|
|
Mathieu-Charles de LIGNIVILLE |
1er juillet 1786, Deuxville,
Saint-Evre (54) ** |
16 octobre 1813, Leipzig (Allemagne) |
|
Chef d'escadrons au 7ème Régiment de
Dragons, tué à la bataille de Leipzig le 16 octobre 1813 |
|
|
Louis de LIGNIVILLE |
25 juillet 1787, Deuxville,
Saint-Evre (54) |
14 janvier 1840 |
14 août 1828, à Lure (70), avec Charlotte-Polycrite
BERTHOD de CRÉVOISIER |
Aspirant de marine en 1803,
officier de cavalerie, sous-lieutenant retraité en 1813 par suite de blessures |
|
|
Rose-Madeleine de LIGNIVILLE |
22 août 1788, Deuxville,
Saint-Evre (54) |
|
| |
|
|
Anne-Victoire de Ligniville |
17 avril 1790, Deuxville,
Saint-Evre (54) |
Avril 1869, Saint-Dié (88) |
12 mai 1850,Nancy, avec M. GENEST DE L'ENGOTHIÈRE
( ?) | |
|
|
Antoine Alexandre de LIGNIVILLE |
20 mars 1792, Deuxville,
Saint-Evre (54) |
6 (ou 29) juillet 1856, Dole (39) |
3 mars 1832 avec
Constance-Simone-Marie-Claudine FERRAND |
Entré à Saint-Cyr en 1810, chef
d'escadron d'état-major en retraite. Chevalier de la
légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis |
|
|
Mathieu-César de LIGNIVILLE |
20 juillet 1793, Lunéville (54,
Paroisse Saint-Epvre,) |
27 novembre 1855, Woinville, Buxières-sous-les-Côtes
(55) |
28 mai 1837, Saint-Mihiel (55),
avec
Joséphine-Charlotte-Nicole de MISCAULT |
Elève de Saint-Cyr (1812), lieutenant
d'artillerie à pied (1813)... Capitaine d'artillerie en
second (1834) puis en premier (1831) (commandant en en
1833 la 15ème batterie du 6ème régiment d'artillerie).
Chevalier de la légion d'honneur (5 mai 1833) |
(*) Outre les mentions de la note suivante,
l'acte mentionne pour Mathieu Joseph : "Grand Bailli d'épée au baillage
royal de Boulai"
(**) Mathieu Joseph est désigné dans l'acte "vicomte de Ligniville, comte du
Saint Empire, chevalier de l'ordre Royal et militaire de Saint Louis, ancien
Capitaine des vaisseaux de la marine Royale de France, seigneur de
Saint-Evre"
|
Note sur Saint-Evre :
Saint-Evre (Sanctus Aper) est un village très ancien,
antérieur au XIIème siècle, voisin de Deuxville,
dépendant de l'abbé de Senones. Au début du XIVème,
Saint-Evre est encore un fief dépendant des comtes de
Blâmont (voir par exemple l'acte de 1310 cité dans
Les Sires et
Comtes de Blâmont). On ignore
quand le village fut détruit, mais le fief de Saint-Evre
subsista : après avoir appartenu à la famille de
Lenoncourt, le fief, qui n'était plus qu'une grosse
ferme, passa à M. de Pullenoy, puis à un membre de la
famille de Haracourt, qui en fit don au jésuites de
Nancy en entrant dans les ordres. Le 25 novembre 1670,
les jésuites échangèrent le fief avec le sieur Dollot,
puis son neveu par alliance, M. de Lombillon, en obtint
la succession le 16 juin 1703. A cette époque la maison
forte était totalement ruinée : Charles Joseph de
Lombillon se chargea de la reconstruire, et obtint du
duc Léopold l'érection en fief du Saint-Empire de haute
moyenne et basse justice le 25 mars 1720. Cependant, en
1724, il l'échangea contre la seigneurie d'Aboncourt au
baron de Schak, En 1729, le fief perdit son titre de
haute justice en 1729. Sans doute la propriété, alors
constituée d'un château bâti à la moderne, d'un
colombier et d'autres dépendances, échut-elle ensuite à
Antoine de Chabot, dont la veuve Marie-Agnès-Dieudonnée
baron de Cordinhowe fit cession à Mathieu-Joseph de
Ligniville, qu'on vit faire ses foi et hommage pour le
fief le 11 août 1785 (même si les actes de naissance des
enfants laissent supposer l'acquisition dès 1783).
|

Carte de Cassini - 1759 |
Au cous du
XIXème, Saint-Evre n'est plus considéré que comme une
grosse ferme dépendant de Deuxville, flanquée d'une
grande maison d'habitation appelée château,
entourée d'un important enclos planté de vignes. La
bataille du Grand-Couronné de Nancy va entraîner la
destruction de la ferme : si Deuville n'avait pas été
envahi lors de la première invasion (du 8 au 15 août),
les Bavarois pénètrent dans Deuxville le 22 août 1914. Mais
le 25 août, se heurtant à une résistance française, ils
sont contraints de se replier sur les fermes de Friscati
et de Saint-Evre, emmenant d'ailleurs en otage le
fermier de Saint-Evre, Albert Robin. Les combats, connus
sous le nom de Léomont-Friscati, dureront jusqu'au 8
septembre et au repli des Allemands, laissant la ferme
en ruine. |
|
La ferme moderne aujourd'hui reconstruite n'est donc pas
la propriété des Lignville où le portrait de famille a
été peint. Peut-être aurons nous l'occasion de découvrir
un jour une carte postale ou une photographie antérieure
à la première guerre mondiale, qui permettrait de donner
une idée de ce que furent les grandes heures de
Saint-Evre au cours du XVIIIème siècle.
|
 |
|
Rédaction :
Thierry Meurant |
|













