Gazette médicale
de Paris
Tome 6 - 1838
Correspondance médicale
Nouvelles remarques Sur le mode de propagation et la nature de
la fièvre typhoïde ; communiquées par M. le docteur PUTEGNAT, de
Lunéville
[...voir article Fièvre typhoïde à
Emberménil - 1838... ]
Archives générales
de médecine
Janvier 1880
ÉTIOLOGIE DE LA FIEVRE TYPHOÏDE DANS LES
CAMPAGNES
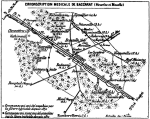
Par M. le Dr ALISON, ancien interne des
hôpitaux de Paris.
[...]
Tout ce qui a été dit au sujet de la fièvre typhoïde peut se
résumer dans les trois hypothèses suivantes, dont chacune
représente un principe étiologique bien différent: la contagion,
l'infection, la spontanéité. Si, en Angleterre, la doctrine de
Murchison a conservé de nombreux adeptes, en France, du moins,
et dans beaucoup de pays, on admet généralement l'existence de
la contagion. Mais qu'il y a loin entre cette manière de voir j.
qui consiste simplement à admettre que cette affection peut être
contagieuse, et l'opinion de W. Budd qui proclame que la
contagion est la cause unique de la maladie. En réalité,
l'éminent auteur anglais n'était pas autorisé, d'après ses
observations, à admettre l'unicité de la cause; puisque les
faits qu'il a relatés démontrent seulement que la contagion a
été reconnue présente dans un certain nombre de cas. Que
faudrait-il, en effet, pour démontrer que la fièvre typhoïde est
toujours contagieuse? Il faudrait, non pas seulement relater un
plus ou moins grand nombre d'observations qui mettent en
évidence la possibilité de cette origine, mais démontrer que la
contagion intervient dans tous les cas de fièvre typhoïde qui se
sont montrés, pendant une époque déterminée et dans toutes les
communes où cette maladie a fait invasion.
Pour notre compte, voici ce que nous avons voulu faire dans la
seconde partie de notre travail : prendre note de toutes les
atteintes de fièvre typhoïde survenues, depuis 1870 jusqu'en
1878, dans toutes les localités de noire circonscription et
rechercher si la contagion existe ou non dans chacun des foyers
que nous avons observés. Des 27 communes qui constituent plus
particulièrement notre ressort médical, il en est 6 qui n'ont eu
à subir, depuis 1879, aucune atteinte de fièvre typhoïde. Au
contraire, dans les 21 localités où est apparue cette maladie,
nous comptons 49 foyers typhoïdiques ainsi constitués:
9 foyers suivis d'épidémie généralisée.
22 foyers dans lesquels la maladie a été circonscrite.
18 cas simples ou isolés.
Plus deux épidémies graves, entées sur l'endémicité. Si nous
mettons de côté ces deux endémies épidémiques dans lesquelles,
vu surtout le chiffre élevé delà population (Baccarat-Deneuvre,
6,000 hab.), l'origine contagieuse est impossible à déterminer,
et si nous étudions ces 49 foyers dans leurs rapports avec la
contagion, voici ce que nous trouvons :
33 fois la contagion a été manifeste.
16 fois la contagion, quoique moins évidente, nous a paru
certaine ; car dans ce groupe sont rangées presque toutes les
atteintes ou foyers consécutifs, survenus à la suite d'une
épidémie provoquée par une importation contagieuse dans des
communes où la maladie n'existait pas depuis un certain nombre
d'années.
En résumé donc, nous aurons à déterminer dans cette seconde
partie, si le contage existe ou s'il est absent, dans ces 49
foyers observés, pendant une période de huit ans, dans les 21
communes de la circonscription de Baccarat..
[...]
Reclonville - Obs: VII.
Reclonville est un petit village de 202 habitants, dont Blamont
est le chef-lieu de canton.
Il est situé sur la rive gauche de là Verdurette, à une distance
de 1 kil. 500 m. d'Ogéviler.
La fièvre typhoïde y fit de grands ravages en 1852. Depuis cette
époque jusqu'en 1873 cette maladie fut totalement absente. Au
mois d'avril de cette année, elle y fut importée par Marie Idoux,
coquetière, âgée de 32 ans, qui allait tous les jours à Ogéviler,
dans la maison d'un de ses cousins et dont la famille était
alors ravagée par la fièvre typhoïde (4 sujets atteints sur 6).
Sa maladie fut grave, mais elle guérit. Elle propagea ensuite la
fièvre autour d'elle, dans sa propre famille d'abord (4
personnes atteintes), puis dans les maisons voisines. Rien que
dans la famille Idoux et dans ses ramifications, on compte 30
malades dont 5 décès.
L'épidémie dura jusqu'en octobre 1874. Elle eut une origine
nettement contagieuse et pendant sou développement, on put
aisément suivre pas à pas les traces de la contagion.
Jusqu'au mois de septembre 1878, il ne survint, à Reclonville,
aucun nouveau cas de fièvre typhoïde^
Obs. VII. - A cette époque tomba malade un jeune homme de 18
ans, Camille Thiébaut, demeurant dans cette commune, et placé,
en qualité de domestique, chez M. A. Garland, cultivateur à
Reclonville. Le 2e jour de la maladie ce jeune homme fut
reconduit dans sa famille. Sa fièvre typhoïde fut grave, dura
jusqu'au 2 octobre 1878, et se termina par la guérison. Aucune
des 6 personnes, dont 4 frères et soeurs, qui composent la
famille Thiébaut ne reprit la maladie, mais A. Garland et sa
femme chez qui il travaillait furent atteints en octobre 1878.
Cependant, le 15 juillet 1879, Théophile, le second des enfants
de J. Thiébaut, âgé de 15 ans, tomba lui-même malade et sa
fièvre typhoïde, qui fut aussi grave que celle de son frère
ainé, dura jusqu'au 15 août suivant. Dans l'intervalle de ces
deux cas de maladie survenus dans la famille de J. Thiébaut, il
n'exista à Reclonville aucun cas de dothiénentérie.
Nous, devons maintenant nous demander si ces deux fièvres
typhoïdes, survenues chez deux frères, habitant la même maison,
couchés dans le même lit, sont reliées par un même lien
contagieux. Or cet enchaînement contagieux, nous l'admettons
pour les considérations suivantes :
1° D'abord le fait qu'un typhoïde s'observe fréquemment, ainsi
que nous le verrons dans une famille où il y a eu, quelque temps
auparavant, un ou plusieurs malades atteints de fièvre typhoïde,
témoigne en faveur de la contagion plutôt que de la putréfaction
; car, en admettant cette dernière hypothèse on comprendrait
difficilement pourquoi un cas de fièvre viendrait à éclore une
année, par exemple, à la suite d'un autre, dans la même maison,
alors que celle-ci a présenté pendant vingt ans et plus, et sans
qu'aucun malade n'ait été vu, les mêmes conditions d'insalubrité
et souvent les mêmes prédispositions morbides individuelles. De
l'aveu des parents et des personnes les plus âgées du voisinage,
la maison Thiébaut n'a pas été depuis l'époque de leur naissance
envahie par la fièvre typhoïde, et même, lors de la grande
épidémie de 1852 et de celle de 1874, on put constater que
celle-ci fut totalement épargnée tandis que les maisons voisines
furent ravagées par cette terrible maladie.
2° Théophile Thiébaut, nous le rappelons, est tombé malade le 15
juillet 1879. A cette date nous avons remarqué, sous
l'influence, sans doute, des chaleurs excessives et des pluies
abondantes qui ont précédé, une poussée typhoïdique dans 6 (Ces
communes sont : Baccarat, Deneuve, Flin, Hablainville,
Reclonville, Vacqueville) des communes de notre ressort médical.
Or, dans toutes ces localités, il y a eu des cas de fièvre les
années précédentes ; tandis que dans les 12 communes qui en sont
restées indemnes depuis quelques années, nous n'avons vu aucun
sujet atteint de fièvre typhoïde.
Comme dans ces dernières, les conditions générales d'insalubrité
et de putréfaction existaient tout aussi bien que dans les
premières, et que du reste la spontanéité morbide individuelle a
pu être aussi bien mise en activité dans les unes que dans les
autres puisque partout il y avait mêmes fatigues, même
alimentation, même température à supporter; nous pouvons en
conclure que ces poussées multiples sont plutôt une preuve en
faveur de la contagion que des autres hypothèses.
Si maintenant, à ces données générales, nous joignons les faits
particuliers suivants: que notre jeune homme Th. Thiébaut n'est
pas sorti de son village depuis plus de deux mois, qu'il n'a été
mis en rapport avec aucune personne soupçonnée d'avoir eu la
fièvre typhoïde, que la maison habitée par la famille Thiébaut
est, pour le moins, dans d'aussi bonnes conditions que les
voisines, que l'eau de consommation provenant d'une fontaine
communale captée avec soin et exempte de toute impureté, nous
pourrons, je crois, admettre que la fièvre typhoïde dont Th.
Thiébaut a été atteint en juillet 1879 est sous la dépendance de
celle dont a été frappé son frère dix mois auparavant.
Or, nous avons démontré que cette dernière s'est montrée à la
suite d'une importation contagieuse ; il convient donc
d'admettre que le contage provenant des matières
excrémentitielles de C. Thiébaut n'avait pas encore perdu ses
propriétés nocives au bout de dix mois, c'est-à-dire pendant la
période de temps qui a séparé la maladie des deux frères.
[...]
Ogéviler, - Obs. X.
Ogéviler est un village appartenant au canton de Blamont et
éloigné de 12 kilomètres de Baccarat. Il compte 597 habitants,
est situé sur la rive gauche de la Verdurette, à 2 kilomètres en
amont de l'endroit où cette petite rivière se jette dans la
Vezouse.
En 1864, une épidémie de fièvre typhoïde y régna, elle atteignit
30 sujets et fit périr 3 malades. Le principe de cette fièvre
avait été puisé au lycée de Nancy, où cette maladie répandait
alors la dévastation, par Ed. Gadel qui était revenu déjà malade
à Ogéviler où habitait sa famille, laquelle compta du reste,
avec celles de Vourion et de Chaton parmi les plus éprouvées.
En 1865, l'épidémie disparut pour ne reparaître que sept ans
plus tard en 1872, année pendant laquelle ce village fut de
nouveau aux prises avec une grave épidémie, également provoquée
par une nouvelle importation. En effet, ce fui à la suite d un
séjour de trois mois à Baccarat, ou régnait une épidémie de
fièvre typhoïde, que Aug. Cherrier, âgé de 51 ans, tomba
gravement malade. Il ne fut reconduit dans sa famille à Ogéviler
qu'au cinquième jour de sa fièvre. La maladie se répandit dans
sa famille et dans les maisons voisines. Il y eut 40 sujets
atteints et 6 décès. L'épidémie dura jusqu'au mois d'octobre
1872 ; la dernière victime fut l'abbé Bunnwarth, curé d'Ogéviler
depuis trois mois.
Une nouvelle épidémie éclata encore dans cette commune en 1877,
c'est-à-dire après un intervalle de cinq ans. D'où venait-elle ?
Un jeune homme de l'endroit, âgé de 19 ans, A. Robert, habitant
une maison isolée, située à deux cents mètres du reste du
village, vint le 19 juin de cette année cultiver un champ de
luzerne peu éloigné de Hablainville; son ouvrage terminée il se
rendit dans ce village et déjeuna chez François, aubergiste,
autour de la maison auquel existaient plusieurs foyers en pleine
activité de fièvre typhoïde. Dès le 13 A. Robert se trouva
indisposé, éprouva tous les symptômes de la maladie, garda le
lit à partir du 18 et eut une fièvre ataxo-adynamique dont il
guérit cependant. Après lui vint le tour de sa soeur qui fut
aussi très gravement malade; puis la maladie passa dans un des
principaux quartiers du village, éloigné de plus de 500 mètres
de la maison Robert, après une importation de second ordre, due
à un jeune homme de 16 ans, Auguste Charrier, qui venait tous
les jours travailler dans un champ tenant à la maison Robert. Il
y eut 22 sujets atteints et 1 décès; le dernier malade fut J.
Didier dont la fille avait eu la maladie cinq mois auparavant.
Obs. X. - Didier Joseph, âgé de 48 ans, demeurant à Ogéviler,
prend la fièvre typhoïde le 31 octobre 1877, dans la maison où
sa fille aurait été atteinte cinq mois auparavant.
Joseph Didier habite une grosse maison de cultivateur, située à
une des extrémités du village. Le jardin, placé derrière la
maison est très étendu et aboutit à la maison Robert où s'est
montré notre premier sujet atteint de fièvre typhoïde. Personne,
même parmi les plus âgés de la localité, ne se souvient avoir vu
un cas de cette maladie dans la maison habitée par la famille
Didier. Depuis quarante ans rien n'a été changé: les écuries,
les fosses d'aisances, l'eau de consommation, tout est resté
dans les mêmes conditions. Qu'il
en soit, Marie Didier, fille unique, âgée de 21 ans, en rapports
fréquents par l'intermédiaire du jardin, avec le foyer
contagieux développé en juin et juillet 1877, dans la maison
Robert, fut gravement atteinte de fièvre typhoïde le 2 juillet.
La maladie dura jusqu'au 10 août : son père fut frappé le 31
décentre 1877. Or cet homme, n'a visité aucune autre famille du
village ou des localités voisines ayant eu des typhoïdes et n'a
eu, nous pouvons le déclarer, aucun contact avec des sujets ou
des milieux contaminés. D'autre part, le principe de la maladie
n'a pu lui venir de l'eau potable, puisque celle dont il faisait
usage était pure et n'avait pu, grâce aux dispositions du
terrain, recevoir des infiltrations soupçonnées de contenir le
principe typhoïque. Nous pouvons donc admettre que la fièvre
typhoïde de Joseph Didier a été contractée dans sa maison même.
Or, un typhoïde avait existé dans cette maison cinq mois
auparavant, et ce sujet atteint n'était autre que sa fille qui
avait puisé le germe de la maladie dans un milieu éminemment
contagieux (maison Robert) ; par conséquent, on peut penser que
le contage typhoïdique, qui avait présidé à l'apparition de la
fièvre de Robert Auguste, importée de Hablainville et de celle
de Joséphine Didier, a dû également provoquer le développement
de la maladie de Didier Joseph son père. Ici, par conséquent, on
peut attribuer à ce contage une durée de vitalité de cinq mois,
puisqu'il s'est écoulé ce temps entre le moment où Joséphine
Didier est entrée en convalescence (août), et celui où la
période d*incubation a commencé pour Joseph Didier, son père.
[...]
Il ne nous reste donc plus qu'à poursuivre cette étude et à
rechercher ce que les autres communes ont présenté de
particulier relativement au développement de la fièvre typhoïde.
Buriville
Buriville est un petit hameau de 148 habitants, presque entouré
de bois de tous côtés. Il est à 2 kilomètres de distance d'Ogéviler
et est traversé par un petit ruisseau renfermant un
lieu infect dont la source est au milieu de la forêt.
Depuis plus de 20 ans cette localité n'avait pas été visitée par
la fièvre typhoïde, lorsque cette maladie y pénétra en juillet
1877. La première personne atteinte fut une femme Mangin, chez
laquelle tous les symptômes prodromiques de la fièvre s'étaient
déclarés dès le surlendemain d'une visite qu'elle avait faite,
le 1er juillet, à Ogéviler où elle avait passé une partie de la
journée chez son oncle Bastien, demeurant vis-à-vis de la maison
Cherrier alors ravagée par la maladie. Cette pauvre femme mourut
au douzième jour d'une fièvre ataxo-adynamique. La fièvre
typhoïde se propagea ensuite dans la maison voisine et dans une
autre située en face de l'habitation Mangin.
Ce petit foyer ne dura que 3 mois. 6 sujets furent frappés; il y
eut 1 décès : il fut donc circonscrit et eut une origine
contagieuse.
[...] |













