A. Dedenon
VÉHO - Éléments de Monographie
1931
SOMMAIRE
1. QUELQUES POINTS D'HISTOIRE LOCALE
1. Les origines.
2. Vého dans le Comté de Blâmont.
3. Vého dans la Châtellenie de Lagarde.
4. Vého déclaré français.
II. DESCRIPTION DU VILLAGE.
1. Population.
2. Le territoire et le village.
3. L'église.
4. Les maires.
5. Les curés.
6. Les régents d'école et instituteurs.
III. LA GRANDE GUERRE.
1. Destruction du village.
2. La reconstruction du village.
AUX HABITANTS DE VÉHO
Cette brochure qui se recommande à votre attention n'est pas un
livre prétentieux, mais une courte et simple notice sur votre
village.
L'auteur, ancien curé. de la paroisse, s'est fait une joie de
rassembler ses anciens souvenirs et de les consigner dans ces
pages.
L'éditeur-imprimeur, enfant du lieu et non des moindres, est
fier d'utiliser ses presses en l'honneur de son pays natal et
d'envoyer, du rivage africain, à ses compatriotes ce témoignage
de sa fidèle sympathie.
Votre cher curé, l'abbé Klein, est heureux de distribuer à tous
ses paroissiens cette étude historique et descriptive.
Voici donc des annales anciennes. Les appellerons-nous annales
de gloire ? Non point, car Vého n'est pas entré dans la grande
histoire, et c'est peut-être un avantage. Nous les nommerons
seulement annales d'épreuves et de consolations, mais où les
souffrances sont plus nombreuses que les joies, comme il arrive
toujours en ce monde.
Ce modeste essai se présente comme un complément de l'Histoire
du Blâmontois et tirera de ce cadre général toute sa netteté,
puisqu'un village n'a de vie que dans sa région et de
physionomie particulière que dans son milieu.
Puisse-t-il intéresser tous nos lecteurs et leur inspirer un
amour plus vif de la terre natale et une estime encore plus
haute de la vie à la campagne !
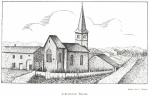
Quelques points d'histoire locale
1. Les Origines.
Toute la région où se trouve Vého était primitivement englobée
dans la Sylva vosagensis : Forêt vosgienne. A quelle date
cessa-t-elle d'être déserte ? Quels furent les premiers lieux
défrichés et habités ? Autant de questions insolubles. On sait
pourtant que, vers la fin des temps gallo-romains, passait non
loin de là, une voie, d'où les premiers colons se sont déversés
sur la contrée. Cette voie a été décrite dans l' Histoire du
Blâmontois. Elle allait du Donon au Léomont et marquait une
étape vers Xousse. Plusieurs localités de ces parages portent
des noms dont la forme latine ou bas-latine indique qu'ils
remontent à cette époque. Ce sont:
Albus mons (Blâmont), Alta petra (Autrepierre), Lenteres (Leintrey),
Xulces (Xousse), Sures (Xures).
Vého n'est point dans ce cas. Néanmoins l'étymologie des noms
peut être utile pour découvrir l'ancienneté des villages.
D'où vient ce vocable ? Les plus anciennes chartes où paraisse
ce mot, l'écrivent: Wihoth (1034), Vïhoz ou Wéhois (1311), Vehey (1380). Ce n'est pas un mot composé, comme le sont
beaucoup de noms de lieux, ni un nom d'accident topographique.
Serait-il déplacé d'y voir un nom propre de fondateur ou de
bienfaiteur ? Ce qui le donne à penser, c'est le point
d'histoire suivant que nous devons exposer.
Depuis le Xe siècle, l'autorité des comtes de Lunéville paraît
évidente sur les terres avoisinant la voie romaine entre le
Donon et Léomont. Les donations qu'ils font à l'Abbaye St-Remy
le prouvent. Elles consistent en biens situés à Frémonville, à
Bénaménil, à Adoménil. Or, un des ancêtres de ces comtes nommés
Folmar et ayant des attaches avec les comtes d'Alsace s'appela
Vuher ou Véher ou même Vernher et il fonda, vers l'an mil,
l'abbaye de Hugoncourt, comme nous l'apprend une bulle du pape
Innocent II. N'y a-t-il pas une ressemblance frappante entre ce
nom et les formes citées plus haut de Wihoth, Wéhois, surtout
Véhey ?
L'argument qui suit est meilleur encore: il repose sur la
donation de 1034 qui mentionne Wihoth pour la première fois. Les
deux fils de Folmar III, le vieux, qui fonda Saint-Rémy, en 999,
se nomment Godefroy et Hermann. Ils ont remplacé les moines de
leur abbaye, devenus indignes, par des moniales ou nonnes, que
gouvernent Adélaïde, puis Uda, soeur d'Adelbéron III, évêque de
Metz. C'est pour les avantager qu'ils détachent, de leur
patrimoine commun, le village de Bénaménil, avec son église;
celui de Frémonville, avec son église: quatre manses à Wihoth,
avec son bois; divers biens à Adoménil.
Cette donation est de 1034. Le bois cité ici est le Rémabois qui
tient son nom d'Hermann, comme Hermamagney, Hermaménil et même
Remoncourt, tous lieux voisins. Vého n'a pas encore d'église.
Ses quatre manses désignent quatre familles de serfs avec leur
habitation et les terres qu'elles exploitent. La population.
n'en compte, sans doute, qu'un petit nombre d'autres. L'origine
de Vého se trouve ainsi engagée dans le sillage de Saint-Rémy de
Lunéville.
2. Vého dans le Comté de Blâmont.
Vers 1140, comme l'indique une bulle d'Innocent III, les
moniales de St-Remy cédèrent, à leur tour, la place aux
Chanoines Réguliers de St-Augustin. Alors, Vého reçut une
chapelle, dans les mêmes conditions que Pessincourt, petit
hameau proche d'Einville. C'était encore l'usage de choisir les
apôtres comme titulaires des églises: la nôtre fut placée sous
le patronage de Saint André.
Le pays de Lunéville s'est formé avec l'aide des moines et
chacun de ses villages fut rattaché à l'un ou l'autre des
monastères qui, existaient aux environs. En étendant sur le pays
sa vaste ramure, l'arbre monacal dispensait largement son
ombrage bienfaisant, je veux dire: l'appui spirituel et
temporel, et, comme un lierre fragile, les petits arbustes
s'attachaient à ses branches vigoureuses.
Au XIIIe siècle, Vého a totalement changé de juridiction, au
spirituel comme au temporel, sans que nous puissions préciser
les conditions de ce changement.
Au spirituel, la paroisse a passé du patrimoine de St-Remy de
Lunéville à celui de l'Abbaye de Saint-Sauveur, peuplée aussi de
Chanoines Réguliers. Elle suivit dès lors le sort de Leintrey,
Reillon, Blémerey et Dornèvre. Cette dépendance vis-à-vis des
Abbés de Saint-Sauveur subsistera jusqu'à la Révolution.
On sait qu'à cette époque les Prieurés assuraient la desserte
des paroisses de leur ressort. Vého et Leintrey, désormais unis,
eurent, comme curés, des Chanoines faisant partie du Prieuré
St-Rémy de Domèvre. Tout proche, le Prieuré du Chesnois, fondé
sur Emberménil pour des Chanoines Réguliers de Chaumousey,
assurait le même service à Domjevin et à Manonviller. C'est le
temps où s'effectua la séparation des dîmes ou redevances
ecclésiastiques d'avec les prestations civiles. Nous possédons
une lettre de l'évêque de Metz, Jean de Vienne, datée de 1365,
qui accorde à l'abbé de Saint Sauveur le droit de patronage sur
les paroisses situées da son diocèse. Vého et Leintrey sont dans
ce cas. (Arch. dép. H. 1374).
Au temporel, Vého fut englobé dans les Etats du puissant Comte
Henri Ier de Blâmont. On sait l'activité de ce seigneur et son
habileté à grouper tous les environs sous sa domination, mais on
ignore les moyens qu'il prit ici pour substituer son autorité à
celle de l'abbaye St-Rémy de Lunéville. Il n'était pas, du
reste, seul seigneur féodal dan ce lieu; Bertrand de Deneuvre y
possédait un petit fief qu'il vendit, en 1312, au dit sire Henri
de Blâmont.
Pendant que Reillon jouissait, nous ne savons pourquoi, des
privilèges de la loi de Beaumont, Vého Leintrey suivaient les
coutumes de Blâmont, tout en gardant les mesures de l'évêché de
Metz, appelées aussi mesures de Vic. Ils avaient donc un doyen
pour prélever les taxes et faire exécuter les ordonnances. La
justice se rendait aux Plaids annaux du Comté.
Mais, à cette grande distance du château seigneurial, le joug
féodal ne pesait guère. Il n'y avait pas de corvée de garde et
peu de corvée de travail. Par contre, la protection du comte
restait bien vague. Nous signalerons seulement une servitude
assez lourde que Vého partageait avec Frémenil. L'origine en est
inconnue. Sa teneur est ainsi énoncée dans les comptes du
domaine: « Les habitants de Vého, conjointement avec ceux de
Fréménil, devront aller quérir jusqu'à Cirey, les bauchons qu'il
conviendra avoir pour couvrir le pont de Domjevin, toutes les
fois qu'il en avait affaire, soit qu'on le refit à neuf ou
autrement, en échange de quoy ils ne payent aucun passage à
Domjevin, comme les autres villages du comté.» (LEPAGE : les
communes de la Meurthe, II, p. 644).
Les crues de la Vesouze endommageaient souvent ce pont et il ne
fallait pas manquer, pour satisfaire un public exigeant, de
faire, en temps voulu, les charrois nécessaires.
Cette servitude se prolongea jusqu'au temps du duc Léopold, qui
fit établir la longue chaussée et les nombreux ponts de pierre
qui. subsistent encore.
En 1308, une incursion de Messins, arrivant par Lagarde, étendit
ses brigandages jusqu'à Deneuvre et fit, à l'aller et au retour,
de grands dégâts, à Domjevin et dans les environs. Le petit
hameau de Frisonviller, situé à l'emplacement actuel de la Bonne
Fontaine, fut détruit dans cette circonstance et ne fut jamais
relevé. Vého eut-il aussi à souffrir ? Les chroniques n'en
parlent pas. On s'étonnerait qu'étant si proche, il fût resté
indemne.
Henri Ier de Blâmont, se croyant près de mourir, prépara, en
1311, son partage de famille: Leintrey fut attribué à son aîné,
mais Vého fut mis avec Domjevin dans la part du cadet.
Ce partage resta lettre morte. Néanmoins l'indication qu'il
portait fut réalisée dans la suite, en 1346 et en 1377.
L'arrangement, pris en cette dernière année, attribua Vého,
Domjevin, Chazelles, Reillon, Laneuveville-aux-Bois, au second
fils de Thiébaut Ier, nommé Adhémar. Celui-ci, étant mort peu
après, laissa sa part à son frère, Thiébaut II, qui était
installé au château de Lagarde. Ce château, appartenant aux
évêques de Metz, venait d'être engagé à la famille de Blâmont.
Qu'on ne s'en étonne pas: les seigneurs de ce temps singulier
s'épuisaient à faire la guerre et, quand ils étaient ruinés, ils
trafiquaient leurs apanages.
Comme Lagarde resta durant près d'un siècle au pouvoir de la
famille de Blâmont, à titre de gage non retiré, Vého finit par
être considéré comme une dépendance de la châtellenie de
Lagarde.
En 1408, mourut, à Lagarde, Jean 1er de Blâmont, son seigneur
éventuel, qui, par testament, légua tons ses droits à Henri IV,
comte de Blâmont, son cousin. Vého rentra ainsi dans le comté.
Bientôt après, l'Eglise de Metz eut pour évêque un prélat
entreprenant qui prit à tâche de réparer les fautes de Raoul de
Coucy et de reconstituer l'ancien Temporel de l'évêché. Le
rachat de Lagarde fut conclu, non sans difficultés, entre 1415
et 1420. Vého fut compris dans ce marché et resta l'un des vingt
villages que comptait alors la châtellenie de Lagarde. Sa
position en fit un îlot messin perdu en pleines terres
blâmontaises.
3. Vého dans la châtellenie de Lagarde.
L'évêque Conrad Bayer de Boppart ne cacha pas sa joie d'avoir
récupéré Lagarde, dont le château, quelque peu délaissé après la
mort de Jean de Blâmont, menaçait ruine. Bientôt son activité
rendit à la châtellenie toute sa prospérité. On sait que les
Évêques de Metz résidaient à Vic depuis fort longtemps, à cause
de l'insubordination des citadins de la ville épiscopale.
Lagarde devint, dès lors, leur maison de campagne, en été. Le
château fut restauré, l'étang aménagé et un moulin construit
pour tous les sujets. Conrad de Boppart y mit un tel soin que,
suivant Meurisse, « cette propriété fut le lieu de toutes ses
terres où il s'aimait le plus, à cause de la chasse qui y était
fort belle. »
La donation de 1506 qui fit passer dans la famille ducale la
possession du comté de Blâmont n'atteignit pas Vého, non plus
qu'Emberménil, Laneuveville-aux-Bois et Xousse. Cependant,
certaines portions de ces derniers territoires étant déjà aux
ducs de Lorraine, furent réunies après coup au comté lorrain de
Blâmont. On eut ainsi des villages qui furent en partie messins
et en partie lorrains.
En 1635, notre village paya, comme ses voisins, son tribut aux
malheurs de la Lorraine; cependant la peste et la famine y
firent plus de victimes que la guerre. On ne voit pas que
l'église ou les maisons y aient subi une destruction ou un
déplacement, sauf peut-être la Petite Vého, aujourd'hui appelée
le faubourg, réduit à trois petites maisons qu'une vague
tradition dit avoir été un hameau plus considérable et détruit
par les Suédois.
4. Vého déclaré français.
Le surnom de « Français de Vého » était naguère encore usité,
comme celui de « Buriville-en-France». Les Lorrains le
prononçaient d'un air narquois. Mais, aujourd'hui, toute
animosité a disparu et le temps a pleinement réconcilié les deux
nationalités. Ce sont les édits de la Chambre d'annexion, rendus
entre 1680 et 1683, qui ont ainsi francisé Vého, Fréménil,
Buriville, Herbéviller et tous les territoires qui auparavant
avaient appartenu, à un titre quelconque, aux Trois Evêchés.
Le XVIIIe siècle se passa sans incident notable.
Les doléances formulées, en 1789, par la communauté n'offrent
rien de spécial, sinon une plainte nettement formulée contre le
moulin banal de Lagarde, où chaque habitant devait faire moudre
ses grains. Ce moulin, disent les cahiers, est trop éloigné. On
gagnerait du temps à se présenter aux moulins plus rapprochés.
Si encore il n'y avait pas de préférences... Mais trop souvent
les gens venant de loin ne passent même pas à leur tour. Ces
abus sont intolérables.
L'abolition des anciens privilèges et l'ensemble des lois
révolutionnaires purent ne pas déplaire aux compatriotes de
l'abbé Grégoire. Cependant on ne vit jamais ces gens, favorables
peut-être à l'idée de liberté, se livrer à des manifestations
exagérées ou à des attentats contre les personnes. Du reste, il
n'y eut jamais de nobles dans leurs rangs.
Qu' est-il resté des anciennes institutions si fort malmenées
par l'opinion moderne ? Nous ne ferons pas grand état des pâtis
communaux, qui cependant sont toujours de quelque utilité pour
les pauvres. Un bien plus appréciable est la forêt, qui depuis
des siècles fournit au village son chauffage annuel. La
jouissance en fut concédée par les évêques de Metz, dans des
formes inconnues.
En 1746, un jugement rendu pour réglementer l'usage des forêts
de l'évêché de Metz, alloua au village de Vého la portion des
bois de Lagarde que nous lui connaissons encore. L'acte en était
conservé aux archives communales, mais il a disparu en 1914.
Après la Révolution, ladite jouissance fut convertie en
véritable propriété foncière. On a beau dire, les maîtres
d'autrefois furent bien avisés dans les avantages qu'ils
faisaient à leurs sujets.
Depuis que Vého est incorporé au canton actuel de Blâmont, il
n'a plus rien qui le distingue des environs et il en a adopté
l'esprit et les usages, tout en conservant les mesures agraires,
qu'il est facile d'adapter aux mesures nouvelles.
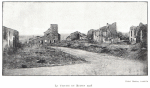
Description du village
1. Population.
On sait que les recensements ne furent en usage qu'après la
Révolution. Dans les temps qui précèdent, la population ne peut
être évaluée que d'une façon approximative.
Au XVIe siècle, le nombre des habitants de Vého ne devait guère
dépasser la centaine. Les malheurs de 1636 réduisirent ce
chiffre à quelques unités. En 1705, un procès-verbal de visite
canonique y mentionne 90 communiants. Au cours du XVIIIe siècle,
la natalité est abondante, comme dans les environs et, vers
1789, le chiffre de 300 est largement atteint.
Les actes paroissiaux, remontant à 1695, auraient pu fournir des
précisions plus exactes, mais ils furent tous détruits en 1914.
Une analyse en avait été faite, permettant de reconstituer la
généalogie de chacune des familles, mais cet écrit lui-même,
d'un intérêt manifeste, a péri, comme les autres archives.
Nous avons retenu quelques notes des familles les plus vivaces
avant 1789 : Bister, Gérardin, Leclerc, L'Hôte, Liotté, Simon,
Thiêbaut, etc...
Trois figures marquantes sont à signaler dans ces temps anciens.
Ce sont trois prêtres contemporains, très liés entre eux, mais
dont le sort fut très différent :
Le premier en date fut CHRISTOPHE LHOTE, né à Vého, le 20 mai
1748. Il fut bénédictin dans le couvent de St-Vanne et St-Hydulphe
de Verdun. Chassé de son monastère par la Révolution, même après
avoir prêté les serments exigés par les lois, il s'en revint
vivre dans sa famille à Vého où il toucha sa pension de 800
livres. Nul ne l'inquiéta pendant les mauvais jours de la
Terreur. Son caractère accommodant ne pouvait porter ombrage à
personne. Nommé constitutionnellement curé à Herbéviller, il
refusa ce poste, se confina dans une prudente obscurité et ne
reprit le culte à Vého et à Reillon qu'en 179B, avec la
tolérance des lois.
En 1B03, l'évêque de Nancy l'ayant envoyé comme succursalier à
Morville-sur-Nied, près de Nomeny, il refusa de s'y rendre, à
cause de sa mauvaise santé. Certains esprits malicieux ajoutent
qu'il aurait pu prétexter aussi son incapacité. Toujours est-il
qu'il resta à Reillon et le desservit jusqu'à sa mort, en
occupant le presbytère ancien situé en face de l'église.
Il fit de nombreuses démarches pour faire rendre à ce lieu son
titre curial, mais il mourut en 1810, sans avoir pu réussir. Il
a laissé un nom honoré et le souvenir d'une vie sans tache.
NICOLAS JENNAT dut naître aussi à Vého, vers 1762; après sa
prêtrise, il fut donné comme vicaire à Grégoire pour administrer
Vaucourt et passa à Lagarde, comme vicaire en 1789. On dit que,
pendant la Terreur, il vécut caché à Martincourt avec Colin,
curé d'Emberménil, connu sous le nom de P. Nicolas.
A la restauration du culte, l'abbé Jennat fut envoyé à Croismare
et y acheva sa carrière. On lui doit la fondation de deux lits à
l'hospice des Vieillards de Lunéville, surnommé le Coton. Les
paroisses qui pouvaient en bénéficier étaient Vého, Vaucourt,
Croismare et Manonviller. L'attribution de ces lits était
réservée au curé de Manonviller.
HENRI GRÉGOIRE fut un personnage bien plus renommé, mais sa
célébrité ne l'exempte pas de graves reproches. Il naquit à Vého
le 4 décembre 1750, de Bastien Grégoire et de Marguerite
Thiébaut. Le père venait d'Azerailles et exerçait l'humble
profession de parementier ou tailleur d'habits. Son logis, situé
vers le milieu du village, était des plus modestes. Une plaque
commémorative le désignait à l'attention jusqu'en 1914. La
guerre l'a renversé comme les maisons voisines.
Ce n'est pas le lieu de détailler ni sa vie publique, ni son
rôle pendant la Révolution. L'histoire les fait connaître.
Lunéville a voulu honorer sa mémoire en érigeant sa statue sur
une de ses places publiques. Rappelons seulement qu'après de
bonnes études faites à Nancy, il fut ordonné prêtre en 1775; il
obtint, en 17B2, la cure d'Emberménil qu'il géra brillamment
jusqu'à son départ pour Paris, en qualité de Député à la
Constituante. Cette fonction publique interrompit son ministère
pastoral, en 1790. A ce sujet, nous pouvons relever un aveu
mélancolique, contenu dans ses Mémoires: « Le temps où j'étais
curé a été le plus beau de ma vie. »
On sait qu'il fut nommé évêque constitutionnel du Loir-et-Cher
et que, toute sa vie, il resta fidèle aux idées
révolutionnaires. Réfractaire aux arrangements du Concordat, il
perdit tout rang dans la hiérarchie ecclésiastique. L'Empire en
fit un sénateur, la Restauration un Pair de France, l'Institut
lui ouvrit ses portes.
D'une vie intègre et même austère, il eut à coeur de remplir
jusqu'au bout les obligations sacerdotales comme la récitation
du bréviaire, mais il refusa de se réconcilier avec le pouvoir
spirituel; aussi, quand il mourut, en 1831, il fut privé de la
sépulture ecclésiastique. Ses funérailles civiles à Paris furent
l'un des gros scandales de l'époque.
La Lorraine ne le revit qu'une fois après son départ d'Emberménil.
Ce fut en 1B03, quand il vint prier sur la tombe de sa mère,
morte à Emberméni1, le 22 septembre 1799. Ses Mémoires relatent
ce voyage. Ses impressions y prennent la forme d'une méditation
saisissante.
Le monument, érigé sur la tombe de sa mère, reçut une longue
inscription funéraire, terminée par ces mots: « Priez Dieu pour
la mère et le fils. » Grégoire vint ensuite à Vého sur la tombe
de son père, et y fit élever encore un monument modeste avec
cette inscription: « Cy-git, attendant la résurrection, le corps
de Sébastien Grégoire, fabricien des Trespassês, époux de
Marguerite Thiêbaut, inhumée à Emberménil, décédé à l'âge de 84
ans, le 27 août 1783, muni des sacrements de l'Eglise. »
En érigeant ce monument à la mémoire d'un père chéri, Henri, son
fils, ancien évêque de Blois, remercie Dieu d'avoir été élevé
chrétiennement par ses vertueux parents, qu'il espère rejoindre
dans la bienheureuse éternité.
Il réclame des prières « pour le père et le fils ».
Bien qu'entachée de fautes graves, cette figure de l'abbé
Grégoire est assez grande, par certains côtés, pour mériter de
survivre dans le souvenir de ses compatriotes. Un tel homme
reste une gloire pour son village natal.
Laissons passer le XIXe siècle. Quand il prend fin, le nombre
des habitants de Vého est en décroissance. Peut-être aimera-t-on
de relire les noms des familles qui s'y trouvent:
Alain, André, Ary, Barchat, Bastien, Bister, Camail, Chatel,
Chatton, Clasquin, Crouvizier, Cuny, Delarue, Friot, Garlant,
Gérardin, Jacquemin, Lavaux, Leclerc, Liotté, Loubet, Magron,
Marchal, Michel, Munier, Perrin, Picard, Pierre, Pierrat,
Rassemusse, Rouillon, Schwartz, Simon, Simonet, Sutter, et
Verlet.
Le souvenir en est cher à tous. Nombreux sont déjà les vivants
de cette époque qui gisent maintenant dans la tombe comme nous
nous y coucherons à notre tour. Le tertre sacré qui a reçu leur
corps est toujours au coeur du village. Jusqu'à ces derniers
temps, la vieille église, témoin des baptêmes, communions,
mariages et funérailles, y abritait leur dépouille mortelle.
Aujourd'hui, ses ruines elles-mêmes ont disparu. Il importe
cependant que ce champ sur lequel plane l'âme du passé, garde à
jamais son caractère religieux, qu'un gazon vulgaire n'y dérobe
pas au regard les dalles funèbres, qu' une croix plantée à
l'endroit où s'offrit le divin sacrifice y dresse son signe
d'espérance, comme c'est le voeu et l'usage de l' Eglise.
2. Le Territoire et le Village.
Le territoire est immense. Il est d'une fertilité moyenne et les
difficultés qu'il présente à la culture dépassent les conditions
ordinaires du travail agricole. Cependant l'habitude aidant,
chacun s'accommode avec la nécessité. Son sol marneux convient
aux céréales et ne renferme aucune pierre. Deux points
culminants: le Haut du Thiut et le Haut de Domjevin, reliés par
la route, créée en 1834, forment avec le fort de Manonviller
tout le relief du paysage.
Le Haut des Vignes a perdu son vignoble depuis trente ans. Que
de noms pareils gardent le souvenir d'usages depuis longtemps
périmés : ainsi le pré-le-prêtre, le pré-du-vin, le champ-des-trespassés,
etc.
Signalons encore, à quelques pas du faubourg, la fontaine
St-André dont l'eau était réputée miraculeuse. La grande croix
de pierre érigée par la famille Simon continue à braver le temps
et les ravages des guerres.
Avant 1914, les maisons du village s'étageaient en deux lignes
parallèles, au revers septentrional de la côte de Domjevin ;
elles étaient au nombre de cinquante, serrées les unes contre
les autres, à la mode lorraine, ignorant le confort et payant
peu de mine. Plusieurs abritaient jadis trois et même quatre
ménages qui usaient du même corridor, parfois même de la même
cheminée.
Jusqu'en 1880, l'école fut logée dans la chaumière vraiment
insuffisante qui était en avant du cimetière. Elle fut depuis
transférée dans un immeuble plus grand, l'un des premiers palais
scolaires de la région, situé en face de la route d'Emberménil.
Un maître de haute valeur, M. Pierre, y enseigna pendant 34 ans.
3. L'église.
La première chapelle de Vého remonte au XIIe siècle. L'ancienne
église, incendiée en 1914, avait été construite au XVIe siècle.
Elle avait tous les caractères de l'architecture usitée à cette
époque: choeur carré, fenêtres lancéolées, loculus du côté de
l'évangile etc... Des édifices semblables se voyaient à
Leintrey, à Reillon, à Xousse, à Fricourt, à Autrepierre.
Comment expliquer cette abondance de constructions en un temps
où nos ancêtres étaient si souvent désolés par la peste ? La
bienfaisance des évêques de Metz, qui étaient alors issus de la
famille ducale, n'est sans doute pas étrangère à tout ce
mouvement.
Vého fut des premiers à réaliser ce renouveau. Personne n'aurait
pu assigner une date exacte à la construction de son église, si
un incident récent ne l'avait révélée d'une façon inattendue.
En 1913, M. l'abbé Colin, alors curé, découvrit au cours d'une
réparation au maître autel, le tube qui renfermait les reliques
et le procès-verbal de consécration de cet autel. L'acte, lu par
M. Pauly curé d'Avricourt, était daté de 1520 et portait eu
substance que « ledit autel fut consacré en l'honneur du Dieu
Tout-puissant, de la B. V. Marie, de Saint André, patron de la
paroisse, et de St-Thièbaut confesseur, par le Révérendissime
Père et Seigneur frère Conrad Heyden, évêque de Nicopolis,
suffragant de Metz, de l'Ordre des Carmes, par mandement de
Jean, Cardinal de Lorraine et évêque de Metz.» Ce prélat, plus
connu sons le nom de Conrad le Payen, était en effet coadjuteur
de Metz à cette époque et mourut, en 1529, après une vie
passée-a Vic, dans les pratiques d'une rare sainteté.
L'édifice, tout entier du même style, était de dimensions
restreintes. Le choeur seul en était resté. La nef devenue
insuffisante au XVIIIe siècle fut agrandie et agrémentée d'une
tour carrée, servant de portail, le tout dans le goût du temps
et d'une banalité justement flétrie sous le nom de style grange.
Cette innovation, qui eut lieu vers 1720, coïncide avec
plusieurs autres améliorations dues au P. Collignon, curé de
Leintrey et de Vého. En 1718, la moyenne cloche - donc la
sonnerie en comportait trois - fut refondue. Peu après, bien
qu'il n'eût pas de presbytère, Vého reçut un administrateur
spécial, un chanoine régulier résidant à Leintrey. En 1760, la
communauté acquit une maison pour loger le prêtre devenu vicaire
résidant. L'immeuble était modeste, il fut utilisé t'el quel
jusqu'en 1880. Transformé à cette époque par un curé
entreprenant, il devint une habitation plus commode sans être
luxueux.
Vers 1770, un incendie détruisit la nef de l'église sans
endommager le choeur ni la tour. On répara les dégâts, mais,
faute de ressources, on négligea d'élever la toiture nouvelle à
la hauteur de l'ancienne. Par suite, la silhouette extérieure du
monument fut irrégulière, le plafond fut trop bas et la pointe
supérieure de l'arc triomphal disparut aux regards. Le
maître-autel en bois sculpté, pareil à celui qui est encore à
Autrepierre et à Laneuveville-aux-Bois, était le seul meuble
ayant quelque valeur.
Pour être médiocre de forme, l'édifice était-il moins vénérable
? Non, certes. Pendant ses quatre siècles de durée, combien de
cérémonies avait-il abritées, toutes vibrantes de piété sincère
et profonde, telle que la ressent l'âme paysanne. L'émotion fut
poignante quand les flammes allumées par les Allemands
enveloppèrent le vieux moutier et le firent effondrer.
La sonnerie comportait trois cloches au XVIIIe siècle. En 1793,
les églises ayant été dépouillées de leur mobilier au profit de
la Nation, les trois cloches prirent le chemin des ateliers de
fonderie pour servir aux besoins des armées. Vers 1820
seulement, les clochers retrouvèrent leur voix d'airain et leurs
gracieux carillons. A Vého la sonnerie rétablie en 1825 eut un
cachet particulier. Ses notes aiguës chantaient en mineur. On se
rappelle avec plaisir le réveil joyeux qu'une vieille tradition
leur faisait lancer à l'aube de Pâques et du Nouvel An. Comme
leurs vibrations alertes martelaient l'air, suivant un rythme
régulier rappelant celui des batteurs en grange ! Vieux usages,
causes de fierté et d'allégresse, qu'êtes-vous devenus ? La
gracieuse sonnerie ne vit pas la fin du siècle. Le 14 juillet
1899, en annonçant la Fête Nationale, la moyenne cloche brisa sa
voix sans cause apparente. Renouveler toute la sonnerie parut le
meilleur parti à prendre et ce fut l'occasion de la rendre plus
forte et de la faire chanter en majeur. La bénédiction en fut
solennelle, au mois de novembre 1900.
Les joies du baptême n'étaient pas oubliées, que déjà se
présentait la :fin. Dans l'incendie de 1914, deux cloches furent
fondues. La troisième fut préservée on ne sait comment et servit
pendant la guerre à jeter l'alarme, en annonçant les
bombardements ou l'invasion des gaz toxiques.
4. Les Maires.
Nous ne pouvons en donner la liste que depuis 1800 :
BISTER (18°03-1823); DIDIER (1823-1836); GÉRARD IN (1836-1837);
LECLERC (1837-1851); LIOTTÉ (1851-1867); BISTER (1867-1873) ;
LIOTTÉ (1873-1876) ; GÉRARDIN (1876- 1877); BISTER Constant
(1877-1887); LECLERC François (1887-1895) ; SIMONET
Jean-Baptiste (1895-1902) ; CLASQUIN Aimé (1902-1912);. MUNIER
Jean-Baptiste (1912-1920); GÉRARDIN Désiré (1920-1928) ; PICARD
Hippolyte (1930).
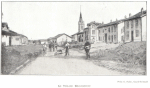
5. Les Curés.
Nous avons dit qu'après les malheurs de 1636, la paroisse de
Vého s'était trouvée annexée à Leintrey ; elle fut donc
desservie depuis 1690 par le saint curé Collignon. A partir de
1718, des administrateurs lui furent donnés:
FRANÇOIS MARCHAL, qui meurt à Leintrey, le 25 mai 1719, âgé de
50 ans; CHARLES CHRISTOPHE (1720-1757) ; P. FRIDERICY
(1757-1761); JEAN-BAPTISTE PARIS (1761- 1766). Tous étaient
Chanoines Réguliers et habitaient Leintrey, sauf les deux
derniers qui se disent administrateurs de Gondrexon où ils ont
leur résidence.
SYLVESTRE BOULANGÉ, lui aussi Chanoine Régulier, fut le premier
à s'installer au presbytère de Vého. Il l'occupa de 1766 à 1778.
Il était né à Lunéville, en 1727. Profès en 1745, prêtre en
1754, il fut vicaire à Marainviller, puis à Thiébaumênil, enfin
à Vého ; il devint ensuite curé de Bettainvillers, jusqu'en
1790. Ayant renoncé alors aux fonctions sacrées, il se
retrouvera, vivant laïquement d'abord à Lunéville, puis à
Bouviller, où la mort l'enlèvera, le 7 mai 1795.
ALEXANDRE FERRY, fut vicaire résidant de 1778 à 1790. C'était un
prêtre âgé. En faisant, en 1790, la déclaration de ses revenus,
il déclara qu'il voulait se retirer de Vého. Il en sortit en
effet et on ne sait ni le lieu ni la date de sa mort.
MARTIN ROLLIN lui succéda. Il résidait à l'abbaye de Domèvre,
comme prêtre habitué. Peut-être reçut-il de l'abbé de Domèvre
une commission régulière et fut-il curé légitime ; toujours
est-il qu'il prêta les serments exigés par les lois et fut nommé
constitutionnellement curé d'Herbéviller. Mais il refusa cette
promotion en alléguant son attachement pour les gens de Vého. Il
passa parmi eux toute la Révolution sans être inquiété. Le
Concordat le confirma dans l'administration de la paroisse et la
mort seule l'en arracha, en 1835. Sa tombe se trouvait au côté
droit du portail de la tour.
Vého n'avait pas le titre de succursale en 1802. Pour l'obtenir,
les habitants adressèrent une pétition aux autorités
compétentes. Ils alléguaient que, depuis cent ans, ils avaient
un prêtre résidant parmi eux, que la population augmentait sans
cesse, que l'église et le presbytère étaient en bon état, que le
titre de succursale était indispensable. Envoyée le 28 août
1809, la demande revint, peu après, avec la faveur accordée.
HOUILLON JEAN-BAPTISTE succéda au précédent, de 1836 à 1848. Né
à Verdenal en 1792, ordonné prêtre en 1816, il devint curé de
Hablainville (1816), de Hesse (1820), de Serres (1823), de Vého
(1836). Retiré à Lunéville (1848) puis à Verdenal (1849), il
mourut le 15 juin 1856.
MARCEL NICOLAS-ALEXANDRE (1849-1855) né à Cirey (1821), prêtre
(1848), vicaire à Foug (1848), curé à Vêho (1849), à Xousse
(1855) jusqu'à sa mort, le 4 janvier 1871.
LEMPFRITT HONORÉ-TIMOTHÉE (1856-1860) né à Lixheim (1803),
prêtre (1827), vicaire à Badonviller (1827), curé de Lesmenils
(1829), aumônier régimentaire (1830), curé de Bernécourt (1833),
retiré à la Chartreuse (1831), curé de Vého (1856), de Borville
(1860), de Morville-lès-Vic (1860), mort en 1862.
COLIN (1860-1879), mort à Vého, inhumé contre la tour du côté de
l'épître.
PESCHER FRANÇOIS-DÉSIRÉ (1880-1882), né à Turquestein (1833),
prêtre (1863), professeur à la Malgrange (1865), curé d'Angomont
(1870), Jésuite (1876), Salésien (1878), curé de Vého (1880), de
Forcelles-sous-Gugney (1889), de Belleau (1890), retiré à Nancy
(1$95), décédé le 4 juillet 1909.
RENEAUX JOSEPH (1882-1887) né dans le diocèse de Metz et
retourné dans ce diocèse après son passage à Vého.
LEBON LOUIS (1887-1892), né à Bezange-la-Petite (1857), prêtre
(1883), vicaire à Baccarat (1883), curé de Vého (r887), de
Malleloy, jusqu'à sa mort (1892-1927).
DEDENON ALPHONSE-JOSEPH (1893-19°0), né à Autrepierre (1865),
prêtre (1888), vicaire à Baccarat (1888), curé de Vého (1893),
de Favières (1900), aumônier à l'hôpital civil de Nancy (1910),
aumônier à Saint-Stanislas (1925).
MEYER JOSEPH-DOMINIQUE-LÉON (1901-1905), né à Dieuze (1872),
prêtre (1896), vicaire à Baccarat (1896.), curé de Vého (1901),
de Domjevin (1905), jusqu'à sa mort (1925).
COLIN MARIE-FRÉDÉRIC (1907-1914), né à Dornèvre-sur-Vesouze
(1876), prêtre (1902), vicaire à Frouard, curé de Vého (1907),
curé de Barbas (1918).
Privée de curé résidant, la paroisse est actuellement
administrée par M. l'abbé Emile Klein, curé de Leintrey.
Qu'il nous soit permis de placer à la suite de ces
ecclésiastiques le P. Henri Marchal, né à Vého, en 1875, prêtre
à Carthage en 1900, Assistant Général de la Société des
Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) que sa vocation et ses
talents rendent cher à ses compatriotes et à ses amis.
6. Régents d'école et Instituteurs.
D'après les actes paroissiaux, citons, comme régents d'école:
Dominique FRACHAY (1741), Jean LAVAUX (1753), Charles LAURENT
(1783), et comme Instituteurs:
GLAUDEL (1840), CLASQUIN (1844), BRIDEY (1856), BRETON, de
Leintrey (1859), qui passa à Foulcrey et à Igney, MONIN (1864),
BALLAND (1865), PIERRE Edouard (1869), maître de grande valeur,
qui resta pendant 34 ans fidèle à Vêho, malgré plusieurs offres
d'avancement et y mourut en 1903, deux ans après avoir pris sa
retraite.
La grande guerre
1. Destruction du village.
Avant la guerre, Vého était un village paisible, laborieux,
aimant ses traditions. La vannerie ajoutait aux ressources
tirées de la terre un utile supplément. Un syndicat agricole
faisait apprécier les avantages de la mutualité. Sous la
direction d'un curé zélé, une société de jeunes gens cueillait
dans les concours des palmes nombreuses par son habileté
musicale. Continuer ainsi dans la paix eût été le bonheur ; mais
brutalement la guerre vint tout briser.
Elle éclata dans les premiers jours d'août 1914. Aussitôt les
troupes de couverture, venant de Lunéville, occupèrent la zone
frontière, en se tenant à 10 kilomètres en arrière. Vého, qui se
trouvait à cette limite, fut rempli de soldats prêts à repousser
les premières incursions allemandes. Les mobilisés se rendirent
à leur poste et les civils anxieux suspendirent le travail des
moissons.
La première collision sérieuse eut lieu, le 11 août, sur la
ligne Avricourt-Blâmont-Badonviller. Les Français cédèrent
quelque peu de terrain jusqu'à la Vesouze. Plusieurs soldats
tués ou blessés furent ramenés à Vého, où l'on improvisa un
cimetière militaire dans les jardins, au haut du village.
L'offensive française du 20 août ayant échoué à Morhange, le
flot allemand accourut aussitôt, pour submerger le pays de la
Vesouze et de la Meurthe. Le 22, de violents combats essayèrent
d'arrêter cette invasion. Notre artillerie tenait les côtes
d'Emberméni1-Blémerey, tandis que nos troupes de ligne
s'échelonnaient devant Amenoncourt, Gondrexon, Chazelles. La
bataille dura deux jours sur ces positions. Vého était criblé
d'obus et rempli de blessés. Puis l'avance allemande déborda
Vého et Emberménil, pour atteindre le fort de Manonviller. Cet
ouvrage, que l'on croyait imprenable, avait été bombardé depuis
Chazelles et, en moins de trois jours, il avait été défoncé. La
garnison se rendit le 26.
La population civile de Vého était toujours là. Du 23 au 30,
elle fut tenue enfermée: les hommes à la mairie, les femmes dans
diverses maisons. Quelques femmes seulement eurent permission de
sortir pour visiter le bétail que soignait la troupe. Aucun
sévices contre les personnes ne fut à regretter. Il y eut plutôt
des incidents comiques où se fait jour l'esprit teuton, comme
cette farce d'un goût douteux, provoquée par la naissance d'un
veau: l'animal est porté dans le lit des propriétaires; puis
ceux-ci sont amenés chez eux pour constater que leurs intérêts
sont bien soignés et, comme ils en restent ébahis, les gros
rires éclatent. Telle est la finesse d'Outre-Rhin.
Pour célébrer la prise du fort de Manonviller, les vainqueurs
sonnent les cloches, relâchent les civils et les forcent à
déménager le fort. Jusqu'au 11 septembre, toute la région en
deçà de Lunéville reste sous la domination allemande. Mais la
victoire de la Marne force l'ennemi à reculer jusqu'à
Sarrebourg. Cependant cette délivrance n'est que passagère.
L'ennemi revient et l'état-major français juge prudent d'abriter
ses positions derrière la Vesouze. La zone qui s'étend au-delà
de cette rivière est sacrifiée. Les patrouilles des deux camps
s'y heurtent en collisions fréquentes et ont la manie d'accuser
les habitants d'espionnage. Vého cependant n'a de ce chef aucun
malheur à déplorer; Emberménil est moins favorisé.
Dès le début de novembre, notre village subit le joug allemand.
Son occupation vint après des combats assez vifs. Ainsi, le 2
novembre, avait lieu un bombardement intense, au cours duquel
furent tués près de l'église le capitaine français Vergnaud et
son ordonnance. Le même jour, une balle d'obus vint frapper Mme
Liotté chez elle et la tua. Une autre balle atteignit M. Bastien
et lui cassa une jambe. Plusieurs dragons furent également tués
sur la hauteur.
Obligés de battre en retraite, les Français laissèrent une
population atterrée et déjà réduite de moitié. Les Allemands, au
contraire, arrivèrent furieux de la résistance qu'ils
rencontraient. N'ayant pas de motif pour maltraiter les
personnes, ils tournèrent leur rage contre l'église. Le 5, les
soldats entassèrent de la paille et des fagots contre l'édifice
sacré et y mirent le feu. Les habitants durent assister
impuissants à l'incendie, jusqu'à l'effondrement du bâtiment.
Les jours suivants ce fut le tour de plusieurs autres maisons.
La période des ravages suédois semblait revivre. Toutes les
nuits, le ciel s'empourprait de rougeurs sinistres ; c'étaient
les villages de la contrée que l'ennemi brûlait l'un après
l'autre, pour effrayer la France.
Les habitants qui avaient eu le courage de rester jusqu'alors
n'avaient plus qu'à songer à fuir vers l'arrière. Les Allemands
ne s'y opposèrent pas. L'exode se fit à la hâte, lamentable. Les
fugitifs se dirigèrent vers Laronxe, Bayon et d'autres lieux où
ils trouvèrent des connaissances. Le village abandonné fut
bientôt détruit par les déprédations que causaient sans scrupule
les patrouilles en campagne.
Bientôt la guerre de mouvement fit place à la guerre de
tranchées qui dura jusqu'à l'armistice. Le front avait fini par
se stabiliser suivant une ligne qui, entre Emberménil et
Chazelles, suivait à peu près la limite des bans de Leintrey et
de Vého, puis de Gondrexon et de Reillon. Vého retomba donc au
pouvoir de l'armée française qui s'y retrancha de son mieux, en
utilisant les restes de ses constructions pour ses ouvrages de
défense.
Quatre longues années se passèrent ainsi, marquées par l'exil
des habitants et par une destruction toujours plus grande du
malheureux village.
2. La Reconstitution. du village.
Aussitôt après l'armistice, les réfugiés accourent vers le pays
natal. Ils veulent voir, de leurs yeux, l'état de leurs foyers
et de leurs champs. Partout le spectacle est navrant. A Vého, le
sol est meurtri, couvert de fondrières et de trous d'obus,
encombré d'engins non éclatés.
A mi-chemin de Leintrey, le chaos est indescriptible, des mines
formidables ont soulevé de vraies montagnes de terre et creusé
des entonnoirs devenus célèbres. Au village, on ne voit plus une
seule maison debout. Beaucoup ne pourront être relevées, à cause
des excavations pratiquées sous leurs ruines. L'église
elle-même, recouvrant un fortin, devra être reportée ailleurs.
C'est l'hiver. Le retour ne pourra se faire qu'à la bonne
saison. L'attente sera longue, mais elle s'impose.
Les survivants se sont comptés et constatent que sept des leurs
sont tombés au champ d'honneur. Ce sont:
Ary Emile, sous-lieutenant, tué le 25 septembre 1915, devant
St-Thomas (Argonne), 39 ans, croix de guerre, légion d'honneur
avec citation.
Allain René, chasseur à pied, tué le 15 octobre 1916, à
Géviremont (Somme), 23 ans, médaille militaire, croix de guerre
et deux citations.
Camaille Paul, chasseur à pied, blessé en Alsace, le 14
septembre 1914, mort à Rochefort, le 11 décembre suivant, 28
ans.
Gérardin Jules, blessé à Neuville-St-Vaast (1915), tué au Ravin
de la Mort (Verdun), le 28 février 1916, 26 ans.
Munier Célestin, chasseur alpin, tué, le 30 novembre 1915, au
Brauen-Kopf (Metzeral), 20 ans.
Picard Paul, artilleur, tué au mont Quesnel (Somme), le 25 avril
1918, 24 ans.
Ary Alphonse, mort le 27 mai 1917, 39 ans, au service du 6e
d'artillerie.
Deux civils ont été également victimes de la guerre:
Marie Rose Simon, femme Liotté Emile, tuée sur sa porte, par une
balle d'obus et le maire Jean-Baptiste Munier emmené en
captivité et mort à Vého, le 24 septembre 1922. Enfin Chéri
André, Auguste Crouvizier, Jules Barchat, Léon Antoine Sutter
ont succombé, peu après la démobilisation, à des maladies
diverses contractées au service de la patrie. Tel est le funèbre
bilan que commémore une plaque de marbre à l'église.
La première installation ne fut possible que dans des baraques
en planches, prêtes seulement en mai 1919. Les familles Marange,
Bister Jean-Baptiste, Crouvizier Jules, Perrin, Robé et Sutter
Jules furent des premières à en profiter. Des prisonniers
allemands avaient déjà fait quelques déblais; le gouvernement
déclara zone rouge 90 hectares du territoire; l'initiative des
habitants remit en état le reste du sol. Il était avantageux de
remembrer le ban et de grouper les parcelles; les propriétaires
le comprirent et l'effectuèrent. Ces opérations retardèrent
quelque peu la reconstruction du village.
Enfin, celle-ci fut entreprise par une Coopérative, installée
pour Vého et Reillon par M. l'abbé Meyer, ancien curé. Cette
association eut, comme Président, J.-B. Bister, et comme
trésorier, Camille Rassemusse. L'architecte en fut M. Desenclos,
d'Epinal, et les entrepreneurs, MM. Dupic et Villain, de
Lunéville.
Cinq maisons furent réparées et quarante et une, au lieu de
cinquante-quatre, rebâties sur des plans nouveaux, plus
confortables. La maison communale fut achevée la première, en
1921 ; les travaux s'échelonnèrent entre 1921 et 1926.
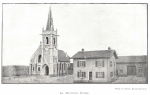
Entre temps, M. l'abbé Emile Klein avait été envoyé à Leintrey
pour réorganiser le service religieux dans les quatre paroisses
de Leintrey, Vého, Reillon, Gondrexon, restées sans prêtres. Les
offices y furent célébrés dans de pauvres baraques en planches
aussi incommodes en été qu'en hiver.
A Vého, la chapelle provisoire fut dressée au faubourg. Une
cloche, survivante et mutilée, appelait les fidèles. Cinq
longues années s'écoulèrent ainsi. Deux fois, la communion
solennelle des enfants n'eut pour cadre qu'une grange, abri
aussi misérable que l'étable de Bethléem.
Pourtant la question de la nouvelle église n'était pas oubliée.
On abandonna l'ancien emplacement, en raison d'un blockhaus
difficile à détruire et pour se conformer à un alignement
meilleur, et on choisit le terrain occupé jadis par le
presbytère et les maisons Lavaux et Rouillon.
D'accord avec la Coopérative des Eglises, M. le Curé Klein sut
réaliser un monument d'un dessin gracieux. La tour servant
d'entrée est placée sur le côté. L'ensemble présente un aspect
nouveau où rien ne choque.
Le 22 octobre 1925, l'édifice terminé put être bénit par M. le
curé, en attendant une inauguration solennelle. Cinq jours
après, avait lieu l'inoubliable fête du baptême des cloches,
sorties des ateliers du fondeur Farnier de Robécourt (Vosges).
La cérémonie avait attiré un nombreux clergé et une foule
débordante de joie. M. le chanoine Gérardin, archiprêtre de
St-Jacques de Lunéville, donna le sermon; M. le chanoine Dedenon,
ancien curé, accomplit les cérémonies rituelles.
Les trois cloches nouvelles égrenèrent ensuite leurs premières
notes: la grosse (sol dièze, 479kg.) en l'honneur de Saint
André, la moyenne (la dièze, 322 kg.) en l'honneur de la Sainte
Vierge; la petite (de, 234 kg.) en l'honneur de Sainte Jeanne
d'Arc. Cette dernière porte, inscrits sur son pourtour, les noms
des soldats du lieu, tombés au champ d'honneur. Puissent-elles
chanter longtemps, avec la résurrection de la paroisse, la foi
et l'espérance de ses habitants. Puissent-elles leur rendre
chères les fêtes religieuses et, aux jours de deuil, pleurer les
morts et consoler les vivants.
Un presbytère est en voie de construction. C'est le dernier
organe nécessaire à toute paroisse. Espérons qu'une fois achevé,
il attirera dans ses murs le curé pour lequel il est préparé.
Désormais renouvelé, Vého est capable de retrouver une
population qui soit aussi nombreuse qu'autrefois et qui devienne
encore plus prospère, à force d'intelligence et de travail.
Que lui faut-il de plus pour retenir l'affection de ses
habitants et conserver sa bonne place et son bon renom dans le
pays blâmontais ?
C'est le voeu que nous formons en terminant ces pages.
Imprimerie des Missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) à
Maison-Carrée (Alger). |













