|
Le Pays
lorrain
1964
Contribution à l'histoire d'Herbéviller
(Meurthe-et-Moselle)
Le grand historien de la
Lorraine, Henri Lepage, a écrit dans l'Annuaire de la Meurthe de
1858 (1) qu'il serait très désirable que l'on étudiât la
situation des classes agricoles et bourgeoises en Lorraine, la
condition des habitants des villes et des campagnes. Nous
croyons nous être conformés ici à son désir.
L'on connaît le rôle important que jouèrent au début de la
Révolution, particulièrement en Lorraine, les hommes de loi, qui
se retrouvèrent si nombreux à l'Assemblée Constituante. Or ce
rôle ne fut nullement improvisé. Depuis longtemps déjà, dans les
petites villes et même dans les anciens villages, ils
consolidaient avec ténacité leur emprise. Tandis que les
seigneurs, insouciants et trop souvent absents, se contentaient,
dans beaucoup de cas, de percevoir leurs revenus et perdaient le
contact avec la population, leurs représentants, avocats,
procureurs, maires, juges, tabellions, huissiers, gruyers, hauts
officiers, formaient un réseau si serré qu'ils étaient, en
réalité, déjà les véritables maîtres du pays bien avant la
réunion des États généraux.
Leur action a sans doute été étudiée. Mais ce que l'on sait
moins, c'est que leur puissance n'aurait pas été ce qu'elle fut
si, en plus de leur mainmise sur la procédure et
l'administration, ils ne s'étaient révélés des terriens qui
s'efforcèrent, par un travail long et patient, d'augmenter en
même temps, pour leur compte personnel, leurs possessions
territoriales, tout prêts déjà à remplacer ceux qu'ils
représentaient.
Ce travail incessant de remembrement, d'acquisition, morceau par
morceau, doit être étudié de très près, dans les archives
notariales, par qui veut connaître les origines et la formation
des hommes de loi. C'est ce que nous avons tenté de faire en
prenant un exemple-type, celui d'une des plus anciennes familles
d'Herbéviller- Launoy, les Pierron. Comme on le sait, cette
localité, qui avait titre de châtellenie au XVIIIe siècle, était
alors du diocèse de Metz et de la subdélégation de Vic depuis
1756, par une de ces anomalies, fréquentes à l'époque, qui
témoignent de l'enchevêtrement des souverainetés.
C'est sous la date du 31 décembre 1693 que nous trouvons pour la
première fois mention d'un Pierron, dans un acte signé J.
Laurent, notaire à Blâmont. Il s'agit d'un échange d'héritages
entre Nicolas Pierron, fermier, qui possédait déjà alors le
moulin de Saint-Martin (2), et les autres hoirs de Françoise
Michel.
Il ne sera ensuite plus nécessaire aux habitants d'Herbéviller
d'aller à Blâmont pour la rédaction de ces ventes, toujours sur
parchemin, souvent avec sceau. Ils vont désormais avoir un
notaire dans leur localité même, assurément plus importante
alors qu'aujourd'hui. Nous avons, en effet, un acte de N.
Jacquot, « tabellion de la terre et seigneurie d'Herbéviller
Launoy », en date du 9 mars 1728, par lequel Nicolas Toussaint,
ancien maire à Herbéviller, « reconnaissait volontairement et
confessait » avoir vendu à « honnête homme » Claude Claudel,
laboureur, demeurant audit Herbéviller-la-Tour, et à sa femme
Jeanne Malay, un pré au lieudit Les Grands-Prés, contenant un
jour 11 toises, soit 58 toises de haut et 4 toises et demie de
large, borné par le sieur Jean Thiry père, au
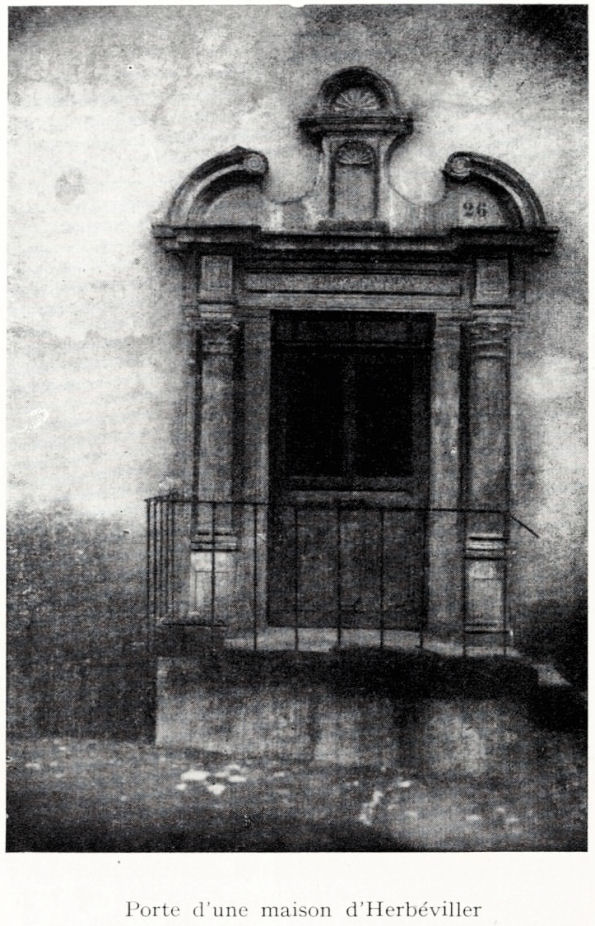
Porte d'une maison d'Herbéviller
sud, et la confrérie
Notre-Dame au nord, au prix de 150 livres et principal et 7
livres 10 sols, plus le « vin que ledit vendeur a reçu comptant
des mains dudit acquéreur ». Si nous avons mentionné cette
transaction, c'est que nous retrouverons ci-après un Claudel
comme vendeur.
C'est sous la date du 25 novembre 1737, donc au moment où la
Lorraine perdait son indépendance, que nous trouvons la première
acquisition d'Alexandre Pierron, « maire, juge et haut officier
de la terre et seigneurie d'Herbéviller Launoy » donc l'homme le
plus important de cette localité que l'on pouvait alors appeler
une petite ville. La transaction s'effectua par-devant le «
tabellionnage de Messeigneurs » d'Ogéviller, seigneurie qui
appartenait alors au rhingrave (Rheingraf und Wildgraf ) de
Salm, par un acte sur parchemin aux armes de ce prince médiat.
Charles-François Jenirat, laboureur à Craon et sa femme
Barbe-Geneviève Houillon vendaient à Alexandre Pierron, époux de
Barbe Boulangé, « un gagnage (3) situé à Saint-Martin, ban et
finage (4) dudit lieu, consistant en terres arables et non
arables, si aucunes y a, et prés, provenant de la succession de
Jeanne Hasselot, vivante femme du sieur Charles Colin, vivant
assesseur et garde-marteau (5) ès prévoté et gruerie (6) d'Einville
» pour la somme de 400 livres tournois au cours de Lorraine en
principal, « et les vins à raison de 5 % ».
Dès lors, les achats d'Alexandre Pierron vont se succéder.
Le 15 janvier 1751, par-devant Me Gauthier, successeur de Me
Jacquot, Nicolas Claudel, laboureur demeurant à Ogéviller
(probablement fils de Claude, mentionné ci-dessus) et sa femme
Marie-Françoise lui vendent deux quarts vingt verges (7) de
terre labourable au lieudit au rupt d'Armont, entre Jean Vourion
au levant, Antonin Mathieu au midi, et sur le chemin de ville au
nord; 1 hommée (8) 9 toises 4 pieds à la Croix Jean-Fleurette; 5
hommées 4 toises et demie sur le chemin des Chaînes; la moitié
de 3 hommées 5 toises 6 pieds proches les meix (9) au delà de
l'eau sur le chemin de Badonviller; enfin 2 hommées 15 toises 2
pieds et demi au lieudit Les Grands-Prés (mentionnés ci-dessus).
Le tout pour 130 livres au cours de Lorraine « et les vins
ordinaires qui ont été consommés entre les parties ».
La même année encore, en 1751, Alexandre Pierron, toujours
qualifié « juge, haut officier en la terre et seigneurie d'Herbéviller
Launoy et y résidant » fait une nouvelle acquisition; il achète
par-devant Gauthier, notaire à Blâmont, à Jean Belleville,
laboureur à Domèvre et à Élisabeth Roussel sa femme, un champ
labourable situé au finage de Saint-Martin, soit six hommées, 23
toises, 2 pieds, pour 68 livres tournois en principal, qui ont
été payées aux vendeurs en espèces coursables (10) dont ils se
sont tenus contents et satisfaits, en outre « des vins à 5 % qui
ont été consommés entre les parties ».
Peu après, le 29 janvier 1753, Alexandre Pierron mentionné cette
fois comme « maire,
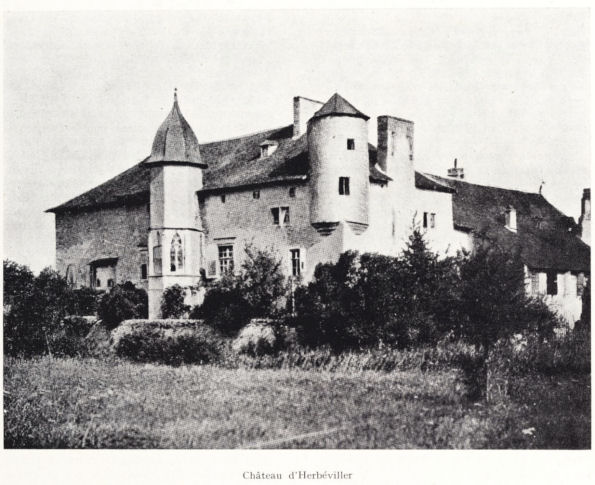
Château d'Herbéviller juge, haut officier et châtelain des terres et seigneurie d'Herbéviller
» achetait par-devant Bertin « tabellion des terres seigneuries
d'Herbéviller » à Joseph Stourme, laboureur à Saint-Martin, une
pièce de terre située sur le ban et finage de Saint-Martin pour
33 livres tournois.
Ce n'est pas tout. Le 26 mars 1753, par- devant François
Décharme, greffier et tabellion commis en la seigneurie d'Herbéviller,
Alexandre Pierron, châtelain, juge et haut officier en ladite
seigneurie (la qualification de maire n'y est plus), achetait à
François Moitrier, laboureur à Ogéviller et à sa femme Jeanne
Claudel, 2 hommées 15 toises de prés situés au lieudit aux
Grands-Prés, pour 75 livres argent au cours de Lorraine de
principal, sans oublier les vins ordinaires.
Alexandre Pierron, qui avait ainsi agrandi ses biens familiaux
de Saint-Martin, transmit ses fonctions de maire, juge et haut
officier d'Herbéviller à son fils François qui vécut peu de
temps après lui. Mais la veuve et les héritiers de celui-ci
poursuivirent les achats.
Le 8 novembre 1779, par un acte signé Gérardin, tabellion à
Herbéviller, mais contrôlé et insinué à Baccarat (qui dépendait
de Metz), ils achetaient de Jeanne-Agnès Helluy, veuve de feu
Clément Hanus, en présence de Jean Mouton père, charron, et de
Sébastien Helluy, laboureur, une petite chenevière (11) sise sur
le ban et finage d'Herbéviller, au lieudit Grand Meix pour 96
livres argent au cours de France.
Enfin, le 22 janvier 1780, les mêmes héritiers de François
Pierron, par-devant le même Gérardin, achètent à Luc Hachaire,
laboureur à Herbéviller, avec le consentement de sa femme Marie
Helluy, et assisté « pour satisfaire au prescrit de la coutume
de l'évêché de Metz » de François et Sébastien Helluy, le
premier son frère, le second son cousin germain, de Jean Vourion
père et de Jean Gled ses neveu et cousin germain, tous
laboureurs à Herbéviller, une autre petite chènevière également
sise au Grand Meix, pour 48 livres argent au cours de France.
Arrive la Révolution : elle n'apparaît ici, au point de vue de
la propriété terrienne, que comme la consécration juridique d'un
état de choses déjà existant en fait. Les hommes de loi de
Blâmont, les Fromental, Lallevée, Zimmermann, Klein, Mayeur,
Batelot et autres, qui y exerçaient déjà en fait la justice et
l'administration, concentrent entre leurs mains les pouvoirs
nominaux des seigneurs défaillants et dirigent le nouveau
district de Blâmont (1790) (12), dans lequel Herbéviller fait
partie du canton d'Ogéviller.
Premiers bénéficiaires de la Révolution, nos hommes de loi sont
aussi les premiers acquéreurs de biens nationaux. Tel est le cas
des Helluy qui, sous l'égide de Fromental, procureur syndic,
achètent le 10 janvier 1792 des terres, prés, friche et
chenevières à Badonviller (13), le 14 février 1792 une maison et
un jardin dans cette même localité (14), le 8 octobre de la même
année un hallier à Blâmont qui appartenait aux religieuses de
cette ville et des terres à Pexonne (15), le 19 février 1793 des
terres et prés à Vacqueville (16).
Mais les événements dépassent rapidement leurs prévisions. Un
certain nombre émigrent, parmi lesquels des Pierron. Aussi
verrons-nous leur nom sur la liste générale des biens des
émigrés du district de Blâmont du 8 avril 1793 (17) : François
Pierron, prêtre à Blâmont « a le bien de sa mère dont son père
jouit ainsi de son patrimoine »; Louis Pierron, médecin à
Strasbourg, « a encore son père et sa mère et n'a rien d'échu ».
Fromental faisait son possible pour sauver les siens sans se
compromettre.
Quelques-uns cependant montent plus haut. Fuyant la situation
quelquefois difficile et en tous cas jugée par eux sans avenir
dans laquelle ils se trouvaient placés en Lorraine, ils vont à
Paris où d'importantes fonctions leur sont dévolues. Tel fut le
cas de Régnier, futur grand juge et duc de Massa, et de
Louis-Dominique Klein, également de Blâmont. Ce dernier, qui
devint successivement général de division, comte de l'Empire,
sénateur, pair de France (18), avait précisément épousé en 1783
Agathe Pierron, fille de François et d'Anne-Louise Helluy, qui
eut dans sa dot la plus grande partie des propriétés de sa
famille sur la commune d'Herbéviller. Le ménage ne fut pas
heureux, Klein répudia sa femme en 1808 pour s'unir avec une
comtesse d'Arberg : il ne revint pas dans son petit pays. Agathe
Pierron se retira jusqu'à sa mort survenue en 1820, à
Herbéviller, et son fils, Édouard Klein, officier en demi-solde
après 1815, vint habiter Lunéville. En 1840, il vendit ses deux
vignes, celle « derrière l'Église » pour 750 F à Verdenal,
meunier à Ogéviller, et le « vieux vignoble » pour 700 F à
Prud'homme, d'Herbéviller. Lorsque lui-même mourut en 1843, ses
filles vendirent à leur tour le reste des terres ayant appartenu
aux Pierron à Herbéviller.
Dans le détail de cette vente, daté de 1852, nous retrouvons
pour la dernière fois les acquisitions effectuées si patiemment
et avec tant de ténacité pendant un demi-siècle par les Pierron.
Mais ils résidaient à Herbéviller : du jour où leurs
descendants, appelés à d'autres destinées, quittèrent leur lieu
d'origine, le lien se trouva rompu.
Il s'agissait en tout d'une vingtaine d'hectares de culture ou
de prés, chiffre déjà assez élevé pour un seul propriétaire dans
un village lorrain - répartis entre les bans de Saint-Martin,
Herbéviller, Blémerey (19), Domèvre et Chazelles (20). Le prix
de vente fut au total de 40 000 F, ce qui prouve que la valeur
absolue de la terre avait baissé. Par ailleurs, la population de
la commune diminuait lentement : 635 habitants en 1800, 553 en
1860.
Chaque ban se subdivisait en saisons et les saisons en cantons
ou lieudits, aux termes d'un morcellement en très petits lots
qui correspondront aux numéros du cadastre.
La culture dans chacun de ces cantons était louée. Nous croyons
devoir donner ci-après les noms de ces locataires de 1852, car
beaucoup d'entre eux achetèrent les parcelles dont ils avaient
ainsi la charge; les habitants actuels d'Herbéviller
retrouveront certainement sur cette liste les noms de leurs
ancêtres et pourront ainsi mieux connaître l'histoire de leurs
propriétés :
Jean-François Cagelot, Joseph Didier, de Saint-Martin, Martin
Philippe, berger à Saint- Martin, Vve Maurice, de Blémezey,
Nicolas Simon, Jean-François Melnotte, Marguerite Duprey,
Jean-Baptiste Hasselot, Joseph Guise, d'Herbéviller, Joseph
Sisler, Jean-Pierre Toulon, Antoine Voinot, Jean-Baptiste
Pierrat, Nicolas Breton, Jean-Claude Simon, Charles Dourdain, d'Herbéviller,
Mangin et Munier, d'Herbéviller, Dominique Putegnat, de
Saint-Martin, Alexandre Godchaux, d'Herbéviller.
Une sorte de loi tendait ainsi, en Lorraine, à ramener la
propriété arable à ce qu'une seule famille pouvait cultiver.
Hubert ELIE
(1) Page 42.
(2) Village voisin d'Herbéviller à droite de la Vezouse.
(3) Pâturage.
(4) Étendue d'une juridiction ou d'une paroisse.
(5) Officier dépositaire du marteau avec lequel on marquait les
bois.
(6) Juridiction de première instance concernant les bois.
(7) Verge, à peu près le quart d'un arpent.
(8) Hommée, quantité qu'un homme peut labourer en un jour. C'est
en Lorraine seulement que ce terme signifiait une division de la
terre d'environ 20 ares.
(9) Jardins.
(10) Qui ont cours.
(11) Terrain où croît le chanvre.
(12) E. AMBROISE, Les derniers seigneurs du district de Blâmont,
M. A. S. 1913-1914.
A. DEDENON, Histoire du Blâmontois dans les temps modernes,
Nancy. Vagner, 1930.
(13) Archives de Meurthe-et-Moselle, Q 431, n° 29.
(14) Id., nos 9, 31.
(15) Id., nos 38.
(16) Id., nos 9, 41.
(17) Archives de Meurthe-et-Moselle, Q 1033.
(18) DEDENON, Notice sur le général Klein, dans Le Pays lorrain,
août 1930.
(19) Sur un épisode concernant cette commune avant la
Révolution, cf. abbé MATHIEU, L'ancien régime dans la province
de Lorraine et Barrois, p. 264.
(20) Id., p. 263. |













